4211km texte et mise en scène de Aïla Navidi, au studio Marigny
// Jan 15th, 2024
© Dimitri Klockenbring
ƒƒ Article de Sylvie Boursier
L’ouverture se situe dans une maternité française avec d’emblée l’image de l’exil, la famille Farhadi perpétue les rituels de la naissance en Iran, chargée d’une batterie de cuisine de couvertures et de chaises. Dès lors le fondu enchainé va relier le présent de l’exil dans une banlieue française aux images fantômes du souvenir notamment à la prison d’Evine, située au nord de Téhéran, aussi célèbre qu ’Alcatraz, connue pour ses salles de torture. Elle abrite encore aujourd’hui tous les opposants au régime. Les panoramiques avec tapis qui se soulèvent et draps abolissent la distance géographique jusqu’à la belle scène finale de deuil. Les Farhadi, militants de la démocratie et laïques, n’imposent aucune culture religieuse à leur fille Yalda, lui inculquant liberté d’expression et d’imagination, naturellement elle témoigne de la saga familiale.
Si l’auteur n’évite pas toujours le discours politico-historique et les bons sentiments, la légèreté des surimpressions et la fluidité de jeu des comédiens prévient toute lourdeur, une mention spéciale à Olivia Pavlou- Graham dans le rôle-titre. Réceptive aux histoires contées, aux récits de la vie quotidienne chuchotés le soir, choyée par ses parents, elle aime la culture occidentale, le rap, curieuse, avide de savoir et de comprendre.
Pour Aïla Navidi écrire, mettre en scène et jouer c’est une façon de parler sans être interrompue, comme Jafar Panahri qui filme clandestinement, depuis son vrai faux taxi le quotidien à Téhéran, accueillant des personnalités ou des anonymes et repoussant la frontière entre fiction et documentaire. Avec le même humour que Marjane Satrapi elle croque sa famille, son pays, les bouleversements historiques, le danger du fatalisme et d’une certaine nonchalance politique dans nos sociétés cosmopolites, message essentiel transmis par Mina et Fereydou, les parents iraniens. On quitte le studio Marigny avec une furieuse envie d’aller dans ce pays du non-retour, sentir les rosiers d’Ispahan et boire un café au Bahar Narenj situé près de la cathédrale Vankar. Là-bas des familles ordinaires sont forcées de mener des existences extraordinaires sous un des régimes les plus répressifs au monde, la chair est triste au pays des mollahs où des jeunes femmes sont étranglées avec leur tchador au détour d’une rue ou, comme Mahsa Amini étouffées pour ne pas le porter.
© Dimitri Klockenbring
4211 km texte et mise en scène de Aïla Navidi
Scénographie : Caroline Frachet
Lumière : Gaspard Gauthier
Son : Erwann Kerroc’h
Avec : Olivia Pavlou-Graham,Florian Chauvet, Aïla Navidi en alternance avec Alexandra Moussai , June Assal en Alternance avec Lola Blanchard, Benjamin Brenière en alternance avec Damien Sobieraff, Sylvain Begert en alternance avec Thomas Drelon.
Du 10 janvier au 25 février 2024 à 20h 30
le dimanche à 16h
Théâtre Marigny / Studio Marigny
Carré Marigny,
75008 Paris
Réservation : 01 86 47 72 77
spectateurs@theatremarigny.fr
Tournée :
28 février 2024 Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas
29 mars 2024 Théâtre Jacques Carat à Cachan
4 avril 2024 Théâtre du Vésinet
11 & 12 avril 2024 Montargis
Read More →
Un sentiment de vie, texte de Claudine Galea, mise en scène d’Emilie Charriot, au Théâtre des Bouffes du Nord
// Jan 13th, 2024
© Jean-Louis Fernandez
fff article de Denis sanglard
Un sentiment de vie, de Claudine Galea, c’est une histoire d’amour entre un père et sa fille traversée par la guerre d’Algérie, par la mort au travail et l’absence que rien ne peut remplacer. Histoire d’une écriture aussi, tissée de souvenirs entre l’Histoire et l’histoire et de cette toujours porosité entre les deux. Ecriture du désastre qui ne résout rien, jamais. Un chant d’amour, cénotaphe littéraire pour un père pied-noir, militaire et colonialiste, taiseux, réac, anticommuniste. Macho désarmé et docile devant sa fille, Antigone camusienne. Ce père entré en agonie, la palais pourri, troué, rongé par le cancer, édenté désormais, qui chuinte plus qu’il ne chante Sinatra, « La Voix », son idole. Voix de l’Amérique et d’une autre guerre, celle de quarante et de la libération, et de sa nostalgie pugnace. Comme le fut l’Indochine. Sinatra qui meurt et le père qui pleure. Et d’une autre guerre encore, son ultime combat, contre la maladie, les larmes et la mort. Une mort dans un jardin éclaboussé de soleil. Sinatra qui acte la paix entre ces deux-là, la fille et le père, en voiture vers l’hôpital… Car si les chansons ne vous donnent pas d’amour, qui vous le donnera ? Longtemps après, My way, arrachera des larmes à Claudine Galéa. My way où le regret de ce qui ne fut pas.
Histoire d’une écriture donc, aussi, de celle qui écrit comment écrire tout ça et de sa genèse, prenant appuie sur un autre récit déflagratoire, My secret garden de Falk Richter, une histoire de père là aussi. Comme s’il fallait en passer par là avant de commencer sa propre histoire. Falk Richter qui cite le dramaturge allemand Lenz traversant les Vosges en sa folie. Et Büchner, lui aussi citant Lenz. Et ces trois d’innerver le récit implacable de Claudine Galéa, surgissant par à-coup, lui donnant sa raison et son impulsion, ses contradictions. Histoire de folie et de mélancolie, où l’écriture, à bâtir des récits puisés au sources du monde et de soi, qui est parfois du pareil au même, vous fait sentir vivant et trembler d’un ineffable « putain sentiment de vie » qu’il faut bien réussir à écrire pourtant. « Un sentiment de vie à vous brûler les lèvres » qui ne sauve pas toujours. Hantent ce récit les fantômes suicidés de Virginia Woolf, Marina Tsvetaieva, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Robert Musil. Claudine Galea met à plat, à nu, le processus de son écriture qu’elle inscrit au cœur d’une généalogie littéraire qui puise dans les traumatismes intimes et le chaos du monde. Et qui l’autorise, parce que l’écriture est là, dans le trauma et sa résilience possible, à écrire à son tour sur son père. Ecriture qu’elle révèle et dénonce dans sa fragilité, sa brutalité, sa férocité, sa voracité et son urgence vitale.
Cette voix aujourd’hui est porté par Valérie Dréville. Dans ce lieu unique du Théâtre des Bouffes du Nord, dans sa nudité volontaire, sa belle austérité, il n’y a rien qui ne fasse obstacle entre elle et le récit. Qui peut expliquer cette présence singulière ? Personne sans doute. Elle est là, posée, debout, au centre du plateau, le geste rare et mesuré. A peine bougera-t-elle, juste quelques pas, d’avant en arrière, c’est tout. Et le temps d’être suspendu, de prendre une épaisseur inouïe, d’être et de devenir celui de l’écriture et du récit, qu’elle fait sienne et sien absolument. De la chair vive et palpitante de cette écriture puissante, incandescente, rageuse parfois, elle en devient le cœur-battant, les nerfs, les muscles et le squelette. Pas d’éclat, nul emportement, aucun effet dramatique dans le surgissement sans violence et fulgurant de cette parole qui s’impose d’elle-même, par elle-même. Une évidence troublante à être là, précisément à cet endroit de l’écriture de Claudine Galéa qu’elle exhausse encore davantage de sa simple présence, sans hiératisme, de sa voix et de son souffle. De cette compréhension intime, intelligente, voire intuitive, d’un texte qu’elle transfigure jusque dans ses silences et non-dit, sentiments comme ravalés, ce qui n’est pas dit, se refuse à être dit, pas encore écrit ou reste à écrire. Ce n’est pas Claudine Galéa qu’elle incarne mais son verbe précis, la trame serrée de cette langue dégraissée de tout afféterie, tendue et qui va à son terme sans crainte de la perte. Elle est là où Claudine Galéa se définit, dans l’écriture seule et sa rigueur nue, dépouillées ici avec raison de tout apparat dramaturgique. Qui donne, impulse sa dynamique, son rythme, sa musicalité originale. Où l’on retrouve là, par ça uniquement et concrètement, ce « putain sentiment de vie » qui traverse plus d’une heure durant Valérie Dréville qui jamais ne faillit ni ne se cabre. Et le théâtre est là, puissamment, lui aussi, dans sa profondeur absolue qui ne demande rien d’autre parfois que l’acteur et le texte, le corps de l’acteur et celui de l’auteur, autrement dit son écriture. On est bouleversé de ça, de cette appréhension-là qui demande abnégation, s’effaçant obstinément et volontairement derrière celui ou celle qui écrit, sa langue ainsi révélée, et fait de Valérie Dréville, oui, depuis longtemps une immense comédienne… Bouleversé aussi d’une mise en scène qui s’efface devant une incarnation qu’on sait pourtant être dirigé au plus près mais qui se refuse à paraitre, se dissimule dans les plis et replis de cette interprétation hors-normes, parce qu’elle n’appartient qu’à Valérie Dréville. Marque d’une grande mise en scène, aussi et surtout dépouillée soit-elle, aussi modeste semble-telle paraître, signée Emilie Charriot.
© Jean-Louis Fernandez
Un sentiment de vie, de Claudine Galea
Mise en scène d’Emilie Charriot
Avec Valérie Dréville
Lumière : Edouard Hugli
Costumes : Emilie Loiseau
Du 11 au 27 janvier 2024
Du mardi au samedi à 20h
Le dimanche 14 janvier à 16h
Durée 1h15
Théâtre des Bouffes du Nord
37bis Boulevard de la Chapelle
75010 Paris
Réservations : 01 46 07 34 50
www.bouffesdunord.com
Read More →

© Roman Kane
ff article de Denis Sanglard
Ils sont sérieux comme des papes, quoiqu’un peu anxieux du fait de leur fragilité, de leurs multiples rétroversions et handicaps dont ils font en préambule de leur conférence la liste exhaustive. Nous voilà donc prévenu, le corps peut lâcher à tout moment, la conférence s’interrompre brutalement. Mais il va tenir et ce à quoi nous allons avoir à faire en la matière s’apparente davantage à une rétroversion du respect de la culture… Plus sérieusement, cette conférence loufoque sur l’amour de l’Art et son discours est un exercice de style complétement azimuté dont le sérieux et l’application force le respect et qui par son décalage permanent provoque un rire inextinguible sinon un effarement joyeux. Nos deux conférenciers, pince-sans-rire, racontent n’importe quoi avec un réel aplomb et du haut de leur autorité souveraine, croient-ils, ne souffrent pas la contestation. L’analyse des tableaux s’apparente davantage ici à une psychanalyse sauvage et lacanienne que sans doute le choix certes pas anodin du sujet, natures mortes et vanités, exception faite de Judith et Holopherne du Caravage, semble de fait induire et provoquer. Entre anachronismes énormes, et raccourcis saisissant, approximation hasardeuse et franche ignorance, c’est plus leur projection mentale quelque peu inquiétante et borderline qui est exposée en ces toiles, un véritable transfert psychanalytique donc, toiles qui n’en demandaient pas tant, ni leurs auteurs. C’est résolument décalé et totalement absurde. Avec ça une propension sévère à faire entrer de force nos préoccupations contemporaines, patriarcat et tout le toutim, dans le moindre sujet et détail de ces toiles que seule la méditation sur notre finitude terrestre occupait en leur siècle où ces questions sociétales ne se posaient pas ou pas encore. Tout à leur conviction affirmée et péremptoirement, la question du contexte semble ne pas être la priorité de nos deux zouaves. Et comme si cela ne suffisait pas, l’unique incursion dans l’art contemporain, un reenactment d’une performance de Marina Abramovic, Oignon (1995), couronne magistralement l’ensemble et pose (enfin) la question centrale de cette création. Entre le discours de l’artiste et le décalage qu’entraîne sa reproduction et son analyse ad libitum, n’y a-t-il pas trahison jusque dans son discours par force vidé de son sens premier ? Autrement dit l’expression même (de l’art) du plagiat dont cette performance serait le symptôme. Et qui autoriserait, nonobstant la bêtise, le docte n’importe quoi plutôt que le silence et la contemplation pure…
Et de façon retorse, poussant la logique jusqu’au bout, dans une juste mise en abîme, eux-mêmes se mettant au final en représentation, qu’ils dénoncent de facto, et donc soumis aux regards et à la critique, sujets à leur tour à l’interprétation que nous pouvons en faire, ne nous exemptant de rien, nous renvoyant à notre propre jugement, nos préjugés et discours. Car que voyons-nous au fond qui ne soit pas un peu de nous-même ? C’est carrément tordu, mais las, empreint de lucidité.
Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier sont bien malins qui loin de ridiculiser nos deux conférenciers leur offrent une vulnérabilité qu’une autocritique salutaire sauve du désastre absolu. « Si le spectacle avait été bien fait… » accuse cette honnête et fébrile inquiétude devant le désastre de leur piteux et drolatiques discours subtilement parodiques et d’une intelligence certaine. Critique d’un discours formaté sur l’art, ses conventions souvent obtuses entre pédantisme et infantilisme masquant difficilement le vide ou le trop plein d’une pensée égarée par tant de beauté, pas loin du syndrome de Stendhal sans doute, qu’il faille absolument lui donner un sens pour ne pas céder au vertige et au néant. Où la recherche du signifiant de la chose, finit par perdre de vue et l’objet lui-même barbouillé par les discours qui s’y afférent et celui qui le regarde. Et c’est bien ça que nos deux énergumènes dénoncent, ce ridicule-là faisant autorité malgré sa vacuité phénomènale qui exclut et rendrait illégitime celui qui n’aurait ni le discours ni surtout sa maîtrise. Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier affirment au final et avec énormément d’humour que l’amour de l’Art se passe après tout très bien de commentaires, le regard posé sur l’œuvre de tout discours. Comme cette chronique pourrait aussi se dispenser de gloser sur cette création qui se suffit à elle-même, pour n’enjoindre qu’une chose : aller donc voir fissa ces deux-là, héritiers lointains de Bouvard et Pécuchet, qui n’expriment rien d’autre que notre vanité orgueilleuse et pédante à masquer notre ignorance.
© Roman Kane
L’amour de l’Art, conception de Stéphanie Aflalo
Ecriture et jeu : Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier
Création vidéo : Pablo Albandea
Régie génerale : Romain Crivellari
Du 10 au 20 janvier 2024 à 19h
Les samedis à 18h. Relâche le dimanche 14 janvier
Durée du spectacle : 1h15
Théâtre de la Bastille
76 rue de la Roquette
75011 Paris
Réservations : 01 43 57 42 14
www.theatre-bastille.fr
Tournée :
24, 26 et 27 janvier Festival Singulier.es
10 février Le Louvre Lens
21 Mars Nantes Théâtre universitaire
Read More →
Curtain Call ! de Judith Rosmair, mise en scène Johannes von Matuschka et Judith Rosmair, Théâtre de la Colline
// Jan 11th, 2024
© Ebby Koll
ƒƒƒ article de Corinne François-Denève
On connait bien l’angoisse du gardien de but au moment du penalty (« Die Angst des Tormanns beim Elfmeter »). On est également familier avec celle de l’actrice la veille de la première : des films comme Opening Night, ensuite transposé sur les planches, l’ont amplement documentée. Ici, ce n’est pas Myrtle Gordon ou Margo Channing qui apparait en scène, cigarette en main, pour dénoncer la cruauté que le théâtre fait aux femmes, et aux actrices. S’agit-il alors de Judith Rosmair elle-même, autrice et actrice de ce Curtain call ! (le point d’exclamation est significatif) ? Dans ses interviews, la comédienne allemande, vue chez Ostermeier ou Ivo van Hove, chez qui elle campait une incroyable Célimène charnelle et affamée de plaisirs, ne fait pas mystère d’une inspiration qu’elle qualifie d’autofictive.
Lorsque commence la pièce, alors que le plateau est baigné d’un très beau clair obscur bleuté, on distingue un corps de femme, allongé sur un lit de fortune. La femme se tortille. Elle psalmodie. « Anna »… « Mamma »… Une régression, une glossolalie ; des mots qui s’associent pour faire revenir des maux, convoquer des fantômes, peut-être toucher, alors, au cœur de l’obscurité, le mystère de l’incarnation. L’actrice cherche à rejoindre celle qu’elle doit interpréter le lendemain soir – rien moins qu’Anna Karénine. Elle n’en dort plus, elle n’en mange plus ; ce rôle l’obsède : sera-t-elle à la hauteur ? Car il y a, demain, inéluctablement, l’appel impérieux du rideau.
L’heure du spectacle couvre la durée de cette nuit. Et la nuit, comme le théâtre, est propice aux évocations magiques : des bottes fourrées, une toque, une machine à fumée, un trombone qui évoque le sifflement du train, oui, voilà, elle est là, Anna Karenina ! Une apparition. Un personnage en quête du corps d’une actrice, qu’il va habiter ou vampiriser. Mais une autre hantise vient à la rencontre de la comédienne, de l’autre côté du pont : celle de « Mamma », qui a fait découvrir à la comédienne, enfant, le roman de Tolstoï ; cette mère dont l’actrice parcourt le journal, à la poursuite de sa propre enfance, ou de révélations.
Pendant un peu plus d’une heure, Judith Rosmair brûle les planches. Elle court, crie, virevolte, déclame, chante. Son texte, d’une grande finesse, passe par toutes les gammes. Pourquoi, finalement, Othello devrait-il être un homme ? Pourquoi pas Othella ? Pourquoi le théâtre se conclut-il toujours sur la défaite des femmes ? Et combien y a-t-il de façons d’accommoder les patates ? Souvent émouvant, le spectacle est aussi très drôle. Rosmair sait en effet tout faire : elle est autrice, actrice, chanteuse, clownesse, danseuse, interprétant et du Kurt Weill et du Serge Gainsbourg, quand elle ne se crée pas elle-même au son d’Ainsi parlait Zarathoustra.
La scénographie est simple et efficace : des praticables, qui dessinent un plateau posé sur le plateau, et qui peuvent figurer la trappe d’un théâtre. La comédienne les manœuvre, les renverse, s’y suspend, gymnaste gracile et légère. Comment un si petit corps, si beau, peut-il être si puissant ? A ses côtés, Johannes Lauer, au trombone, au piano et à l’euphonium, vient ponctuer le texte. Une heure dix en allemand surtitré – mais le surtitrage, aussi, est somptueux : le nom de Vronski répété qui dessine un cœur, comme dans un calligramme adolescent et sentimental, les recettes de patates en forme de liste oulipienne…
La nuit remue et se termine. A-t-on rêvé ? Sommes-nous faits de l’étoffe dont sont tissés les songes ? Où est Anna Karénine ?
© Ebby Koll
Curtain Call !, de Judith Rosmair
mise en scène Johannes von Matuschka et Judith Rosmair
avec Judith Rosmair et le musicien Johannes Lauer
musique Uwe Dierksen
traduction Uli Menke
Du 9 au 21 janvier 2024, du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h
Durée : 1h 10
La Colline — théâtre national
15 Rue Malte-Brun
75020 Paris
Réservations : 01 44 62 52 52
www.colline.fr
Read More →
40° sous zéro, l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer & les quatre jumelles, de Copi, mise en scène de Louis Arène, Cie Munstrum, Au Théâtre du Rond-Point
// Jan 10th, 2024
© Darek Szuster
ƒƒƒ article de Denis Sanglard
40° sous zéro, c’est complètement givré ! Un Copi follement queer. Deux pièces du dramaturge argentin qui n’aurait sans doute pas renié cette mise en scène hallucinée. Des créatures hors-norme, pas d’autre terme, pour une cérémonie foutrement trash. C’est du grand-guignol burlesque, grotesque et punk. Et sophistiqué avec ça ! Costume de Lacroix, rien que ça, tout aussi barré lui aussi, qui pour l’occasion donne dans le recyclage haute-couture. Ça tranche, ça saigne. Ça chie, ça chiale. Ça éructe. Ça se pique, ça sniffe. Ça s’entre-tue, ça crève salement et ressuscite illico. Copi n’avait pas de limite et se foutait de la vraisemblance comme d’une guigne. Usait et abusait du cliché qu’il sublimait comme pas un. Empilait les stéréotypes qu’il détournait et magnifiait. Théâtre minimaliste, pauvre même, et paradoxal. Chez Copi tout déborde, dégorge. Théâtre faussement naïf, férocement transgressif. Tragique aussi mais d’une crâne insolence et qui ne prend pas de gant pour vous mettre un doigt d’honneur bien profond dans le fondement de la bienséance et de la normalité. Théâtre merveilleusement, heureusement scandaleux qui voit les exclus de tous bords, pas même gentils, cul par-dessus tête se foutre du genre – déjà – et affirmer avec une frondeuse fierté leur différence, leur monstruosité. Oser, objet de scandale, être eux-même enfin. Le rire chez Copi est un rire de résistance.
Louis Arène exhausse tout ça, embrasse Copi furieusement qu’il finit par retrousser pour en exhiber les dessous, cette vérité toute crue qui dérange encore. Entre télé novelas ou vaudeville sous acide, c’est tout à la fois d’une élégance de folle furieuse, entre kitsch et chic frelaté, respectant à la lettre tout en y mettant son grain de gros sel, ce théâtre de la cruauté, voire existentialiste. Ce sont des monstres fabriqués et leurs prothèses, qu’ils finiront par s’arracher dans une bataille épique, pleine de coke et de fureur, les laissant à nu, participe de ça, de cette création, de la fabrique et de l’affirmation de soi jusqu’à l’excès, l’outrance volontaire et férocement joyeuse. Tout est illusion, tout est théâtral et parfaitement assumé, affirmé. La Russie ou l’Alaska, c’est du pareil au même, c’est ici ou là, c’est n’importe quoi, autrement dit nulle part. Les seringues sont vides. Le revolver fait pan ! Le sang gicle, rouge fluo. La coke c’est de la poudre de Perlimpinpin. Il suffit d’y croire, point. Louis Arène s’amuse comme un sale gosse, en rajoute une grosse louche, fait le pari de la démesure, de l’énorme et du mauvais goût devenu la norme et réussit son coup. Plus c’est gros, mieux ça passe et la jouissance est là, qui gicle sans à-coup, ce rire qui ébranle la salle. Une salle complice et pas dupe que tout ça, c’est du chiqué, c’est pour de faux. Avant d’être fauchée abruptement par un final apocalyptique qui voit basculer cette farce existentialiste dans un registre des plus inquiétant.
Louis Arène, Lionel Lingelser, Sophie Botte, Delphine Cottu, Olivia Dalric, Alexandre Éthève et François Praud, au diapason, sont aussi hors-norme. Rien ne leur semble impossible dans cet univers absurde et féroce qu’ils traversent au pas de charge. Ils sont tous simplement extraordinaires, ne dépassant jamais les bornes dans la démesure, toujours justes dans cette folie, dans ce burlesque haut en couleur et crue, cet univers queer et drama-queen sous haute-pression qu’ils transcendent par ce naturel et cette aisance, cette extravagante vérité dans l’invraisemblance.
© Darek Szuster
40° sous zéro, L’homosexuel où la difficulté de s’exprimer & les quatre jumelles de Copi
Mise en scène Louis Arène
Avec Louis Arène, Sophie Botte, Delphine Cottu, Olivia Dalric, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, François Praud
Conception Louis Arène, Lionel Lingelser
Dramaturgie Kevin Keiss
Assistante mise en scène Maëliss Le Bricon
Stagiaire mise en scène Mo Dumond
Création costumes Christian Lacroix
Assisté de Jean-Philippe Pons et Karelle Durand
Scénographie, masques Louis Arène
Création coiffes, maquillage Véronique Soulier-Nguyen
Création lumières François Menou
Création sonore Jean Thévenin
Assisté de Ludovic Enderlen
Regard chorégraphique Yotam Peled
Assistant scénographie, régie générale, accessoiriste Valentin Paul
Régie lumières Julien Cocquet
Accessoiriste, régie son Ludo Enderlen
Assistant accessoiriste Julien Antuori
Habilleuse Faustine Boyard
Cheffe d’atelier costumes Lucie Lecarpentier
Costumières Tiphanie Arnaudeau, Hélène Boisgontier, Castille Schwartz
Stagiaires costumes Marnie Langlois, Iris Deve
Du 11 au 27 janvier 2024 à 20h30
Samedi à 19h30, relâche dimanche & lundi
Théâtre du Rond-Point
2bis av. Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
Réservations 01 44 95 98 00
www.theatredurondpoint.fr
Read More →
Toucher au nerf, de Maguy Marin, conversation avec Olivier Neveux, aux Éditions Théâtrales
// Jan 8th, 2024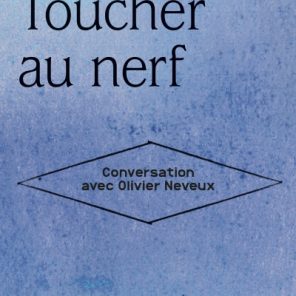
ƒƒƒ article de Nicolas Thevenot
Ni méthode à proprement parler, ni recension complaisante ou satisfaite d’un parcours artistique renommé, le livre d’entretiens de Maguy Marin avec Olivier Neveux, agrémentés de trois interventions de la chorégraphe, déploie une pensée sur le vif, tramée dans l’épaisseur d’un geste. Et c’est la force et la singularité de l’approche éditoriale d’Olivier Neveux que d’en avoir conservé le caractère propre au temps conversé, affirmé et multiple à la fois, parfois contradictoire, toujours sur le qui-vive de la précision ou de la correction à apporter, et de lui savoir gré d’être une pensée en action, à toujours parfaire et précieuse pour cela même, arrimée à une pratique quotidienne des corps et du collectif. A travers les mots, au détour des situations narrées, comme dans un livre de Modiano, se détache une autre figure, perceptible dans la réapparition de certains traits dans la scansion des époques remémorées par ce regard rétrospectif et actuel : celle d’une posture éthique, politique, d’une artiste interrogeant en permanence sa propre méthode. En cela elle est proprement exemplaire.
De cet échange à bâtons rompus émerge finalement une méthode de la méthode. Un rapport à soi-même et aux autres, une relation critique au monde et à ces structures. « La violence du monde, elle, ne se calme pas. Le risque d’une adaptation à cette violence, c’est de crier parce que ça fait mal, puis de crier parce que ça fait bien ». Tâtonnant, cernant et discernant son objet, sa quête, qui semblent se redéfinir et se redéployer au fur et à mesure qu’elle progresse, Maguy Marin tient d’une main ferme sa baguette de sourcier, sensible aux fracas, aux tracas, comme aux forces invisibles qui dominent et aliènent la société, et trace sa ligne de crête, pour reprendre le titre de l’un de ses spectacles récents. Sans cesse, sans jamais flancher, elle n’a de cesse de s’en tenir à une exigence pour soi-même comme pour les autres, danseurs ou spectateurs, alliant une rigoureuse recherche, un patient travail, à une colère qui ébroue autant les affects que l’intellect. Il faut se souvenir du scandale d’Umwelt, et la chorégraphe de rappeler les difficultés connues après la création pour faire tourner cette pièce-là alors qu’elle rencontre aujourd’hui le succès. Ce qui n’est pas sans interroger et n’entame en rien la colère créatrice de Maguy Marin. La lecture de Toucher au nerf produit aussi cela en miroir : un questionnement réflexif sur sa propre posture de spectateur : qu’en est-il de nos ressorts ? de notre propre exigence, de notre rapport aux modes spectaculaires, de notre facilité à succomber au divertissement qui n’est que diversion…
Outre l’exposition des grilles polyrythmiques à l’œuvre dans nombre des pièces de la chorégraphe, agissant souterrainement et structurellement dans le processus de fabrication, rappelant combien la question du rythme est de nature politique autant qu’esthétique (« [..] mais non, personne ne va trop vite ou trop lentement, c’est juste qu’ils n’étaient pas connectés. Le travail du rythme, c’est ce qui fait cette attention particulière que les gens ont les aux autres »), l’autre fil rouge de cette conversation est le rapport de Maguy Marin au langage qui, de la table préparatoire, sous-texte et pré texte d’un spectacle à venir, a progressivement pris part de façon explicite dans l’œuvre, comme par exemple Y aller voir de plus près, qui instaurait au plateau la lecture de La guerre du Péloponnèse de Thucydide. Par cette démarche, par cette volonté de se colleter à et de faire entendre des textes de penseurs, d’historiens ou de poètes, dans ce rapport d’humilité vis-à-vis du livre qui impose autant qu’il peut effrayer, c’est comme si une parenté inattendue se faisait jour entre la danseuse chorégraphe et l’écrivain Pierre Bergounioux : c’est, écrit dans leur chair (et pour cela, ils me troublent autant l’un et l’autre), que le langage est aussi affaire de domination, que la parole et l’écrit recèlent, sous leurs ors, une injonction à la soumission de la classe démunie. L’origine sociale augure l’absence de légitimité quand il s’agit de s’emparer des mots. L’onde de choc de la domination vibre entre les corps et les mots des dominés. Le tournant pris par Maguy Marin, insérant le langage dans le champ de sa danse (quand les mots étaient jusque-là dévolus au théâtre), est d’une remarquable pertinence si l’on veut bien reconnaître que les mots comme les corps, mais plus invisible que ces derniers, sont les vecteurs et les marqueurs des relations de domination qui entrelacent le monde. Ils sont d’une certaine façon le nerf de la guerre, et les réactions, quelque peu réservées, accueillant ses dernières pièces et reprochant une trop grande explicitation, devraient à cette aune être elles-mêmes interrogées. Cet explicit content porté par Maguy Marin, comme une faute de goût dénoncée par ceux qui s’arrogent le bon goût, est un acte politique autant qu’artistique. Les deux sont inséparables. Toucher au nerf révèle un chemin d’émancipation qui n’en finirait pas de mettre à jour les chaines qui nous entravent. Et sa lecture passionnante de remobiliser nos rages assoupies : « Je ne veux pas trop me discipliner, je veux garder ma rage…J’ai envie de défendre cette capacité que nous avons de rendre la violence qui nous est faite. C’est tout. »
Toucher au nerf, de Maguy Marin
Conversation avec Olivier Neveux
Éditions Théâtrales
Octobre 2023, 138 p., 19€
https://www.editionstheatrales.fr/
Read More →
Invisibili, conception, scénographie et mise en scène d’Aurélien Bory, au Théâtre de la Ville / Les Abbesses
// Jan 8th, 2024
© Rosellina Garbo
f article de Denis Sanglard
Inspirée d’une fresque palermitaine du XVIème siècle, le triomphe de la mort, chevauchée macabre reproduite à l’identique sur le plateau, la dernière création d’Aurélien Bory est tout entière habitée par le sujet de cet emblème de Palerme. La mort au travail dans son aspect le plus intime, le cancer, ou politique et collective, la traversée tragique des migrants. Danse fortement illustrative empreinte de théâtralité, hantée par la chorégraphe Pina Baush dont Aurélien Bory semble rendre un hommage un peu trop appuyé, Palermo Palermo pour mémoire, pièce iconique dont le souvenir ne cesse de vouloir surgir par effraction au sein de cette création. C’est d’ailleurs dans une citation directe et explicite qu’Aurélien Bory avoue ce faux palimpseste, on peut dire cela, image puissante et prégnante de chaises de bistrot sur un plateau vidé de ses danseurs, secouées de tremblement incontrôlés, allusion aux tremblements de terre coutumiers de la Sicile mais aussi au violent séisme chorégraphique et scénographique (le mur de parpaing s’écroulant dès les premiers instants) que fut cette création inspirée par la ville de Palerme. C’est donc dans le même moule et les mêmes pas que se glisse Aurélien Bory auscultant Palerme à l’aune d’une fresque emblématique. Scène médicale de palpation d’une poitrine, canot bousculé, renversé par les flots, c’est le même traitement, celui d’aller jusqu’à l’épuisement du mouvement et de la séquence, toujours réitérés. Avec des glissements et décalages qui emmènent irrésistiblement vers d’autres lectures, d’autres empreints, d’autres sources. Ainsi de ce chant, Hallelujah de Leonard Cohen, qui se métamorphose en longue plainte, celui sans doute des pleureuses palermitaines ou des chants traditionnels des frères Mancuso, chanteurs siciliens vus, entre-autre, chez l’artiste Emma Dante (in Verso Médéa, 2016). Avec toujours centrale et point focale cette fresque impressionnante, immense toile évoquant les ravages de la peste, la mort à cheval et son arc noir éradiquant chacun sans distinction de classe, qui se meut, ondule par vagues, absorbe les corps agonisants ou recrache ses victimes et rescapés d’une mer démontée. Devenue espace mental autant que physique et géographique, culturelle même, qui imprègne l’ensemble , qui se fond en elle, dont en premier lieu les quatre danseuses, toutes de Palerme, et de l’unique danseur, le musicien nigérien Chris Obéhi, lui-même migrant ayant survécu à la traversée pour Lampedusa racontée ici.
Aurélien Bory se nourrit de la gestuelle des figures peintes, s’arrête et zoome sur des détails pour donner son impulsion à cette chorégraphie où la mort se dispute à la vie, reproduire une danse macabre, ronde infernale et mécanique comme inspirée de l’opéra dei pupi traditionnel propre à la Sicile et comme surgissant tout soudain de la fresque devenue ici l’épicentre de nos fléaux contemporains. Alors pourquoi peine-t-on à être ému devant tant de gravité affichée et volontaire ? Devant des images souvent d’une réelle beauté ? Sans doute qu’Aurélien Bory à tant appuyer, à tant vouloir démontrer, épuise le sens même de ces images d’une beauté âpre et sèche qu’il vide paradoxalement de sa profondeur par sa répétition même et sa littéralité brute que ni la danse aussi théâtrale soit-elle ne réussit à dépasser. Là ou Pina Baush jouait de la brièveté, de la concision, voire de l’ellipse, n’étant jamais démonstrative mais laissant toute la place à l’imaginaire fermement ancré à une réalité indépassable, Aurélien Bory comme emporté par les images créées et par une volonté sans doute généreuse de démontrer absolument prolonge plus que de raison celles-ci sans jamais dépasser le premier degré jusqu’à en oublier l’invisible des choses propre à toute création. Cela finit par lasser et nos yeux de rester sec non devant les malheurs du monde mais, ici, de sa représentation.
© Rosellina Garbo
Invisibili, conception, scénographie et mise en scène d’Aurélien Bory
Collaboration artistique, costumes : Manuela Agnesini
Collaboration technique et artistique : Stéphane Chipeaux-Dardé
Musique : Gianni Gebbia, Joan Cambon
Musiques additionnelles : Arvö Part Pari Intervallo (Transcription Olivier Seiwert), Léonard Cohen Hallelujah, J.S Bach Gigue, 2éme suite pour Violoncelle
Création lumière : Arno Veyrat
Décors, machinerie et accessoires : Hadrien Alboury, Stéphane Chipeaux-Dardé, Pierre Dequivre, Thomas Dupeyron, Mickaël Godbille
Régie générale : Thomas Dupeyron
Régie son : Stéphane Ley
Régie lumière : Arno Veyrat ou François Dareys
Régie plateau : Mickaël Godbille, Thomas Dupeyron
Avec : Gianni Gebbia, Blanca Lo Verde, Chris Obehi, Maria Stella Pitarresi, Arabella Scalisi et Valeria Zampardi
Du 5 au 20 janvier 2024
Du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h
Théâtre de la Ville / Les Abbesses
31 rue des Abbesses
75018 Paris
Réservations : 01 42 74 22 77
www.theatredelaville-paris.com
Read More →

ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia
Trois musiciens débarquent dans la toute petite salle du Théâtre de Poche – Montparnasse. L’un d’entre eux déballe partitions, livres et thermos de thé sortis d’une petite valise. C’est comme l’étalage d’une vie, les essentiels emportés par l’artiste sur la route du départ, le départ d’un lieu que l’on sait que l’on quitte sans avoir la certitude de ce que l’on va trouver, mais parce que l’on sait qu’il faut partir (« ne cesser de partir d’ici, c’est seulement comme cela que je pourrai atteindre mon but » comme le conte joliment Kafka dans Le départ).
Dans Notes de départ, le trio Degré 41 (du nom d’un groupe poétique avant-gardiste fondé par les exilés russes à Tbilissi en 1918) enchaîne une alternance de textes de nature poétique ou philosophique émanant principalement d’auteurs russes très connus (Daniil Harms, Irène Némirovsky, Viktor Pélévine, Anton Tchékhov) auxquels il faut ajouter Baudelaire et Kafka, et de morceaux musicaux composés notamment par Vadim Sher, le pianiste du trio, qui est le principal narrateur et lecteur, aux côtés de l’excellent clarinettiste Yuri ukrainien Shraibman et du violoniste estonien Dimitri Artemenko.
Avec humour ou mélancolie, différents types de départs sont donc mis en musique dans un mélange de tradition tzigane, klezmer, slave, caucasienne, en textes (dont les choix sont inégaux en dépit de leurs auteurs prestigieux) et même en images, avec un très joli film d’Igor Minaév sur un nouveau départ qu’est le mariage, avec ce qu’il suppose de renoncements et de glissements (aux sens propre et figuré).
Les émotions provoquées par le départ, le sien, de ses proches, sont interrogées : joie, tristesse, folie, souffrance extrême. En attendant le départ définitif, celui où « nous quitterons cette terre pour toujours » et en convenant avec Olga dans les Trois sœurs, que « notre vie n’est pas encore terminée. Il faut vivre ! La musique est si gaie, si joyeuse ! Un peu de temps encore, et nous saurons pourquoi cette vie, pourquoi ces souffrances… Si l’on savait ! Si l’on savait ! ».
Notes de départ, conception Trio Degré 41
Musique : Vadim Sher, Dimitri Artemenko, Alfred Schnittke, Valeri Gavriline
Mise en espace : Carolina Pecheny
Mise en lumière : Alireza Kishipour
Images cinématographiques : Igor Minaév
Avec : Vadim Sher (piano), Yuri Shraibman (clarinette, saxe), Dimitri Artemenko (violon)
Jusqu’au 6 janvier 2023
Les vendredis et samedis à 19h
Durée : 1h15 mn
Théâtre de Poche – Montparnasse
75 boulevard du Montparnasse
Paris 6ème
www.theatredepoche-montparnasse.com
Read More →
A Simple Space, par la troupe Gravity & Other Myths, à l’Espace Chapiteaux de la Villette
// Déc 26th, 2023
© Steve Ullathorn
ƒƒƒ article de Hoël Le Corre
Rarement titre de spectacle n’aura été si explicite, et rarement troupe de cirque n’aura aussi bien porté son nom : sur un praticable d’une sobriété absolue, d’une vingtaine de mètres carré guère plus, les huit circassiens défient toutes les lois de la gravité en nous proposant un spectacle sur-vitaminé qui nous subjugue sans jamais oublier de nous faire rire ! C’est peut-être ça la recette du triomphe de ce Simple Space qui a été déjà été joué plus de mille fois à travers les cinq continents depuis dix ans…
Sur cette petite scène qui rappelle un ring de boxe vont se succéder, sans fard, sous les yeux d’un public très proche de cet espace, des acrobaties hallucinantes. De salto arrière en pyramides humaines, les artistes passent de l’individuel au collectif avec une fluidité déconcertante, que seule une maitrise parfaite du corps de chacun et des chorégraphies de groupe peuvent offrir. Les corps virevoltent, s’entremêlent, rebondissent, se déploient, s’envolent, dans une énergie débordante ; et si d’aventure la chute est proche, il leur suffit de crier « falling !» pour être rattrapé par l’un des leurs dans une solidarité euphorisante. Car oui, complices ils le sont, et à plusieurs mètres au-dessus du sol, il vaut mieux que la confiance règne. Et pour nous spectateurs, c’est un plaisir de voir leurs regards, leurs sourires, leurs gestes se soutenir et s’encourager sans cesse.
Cette profonde connivence leur permet également de se lancer dans des défis aussi cocasses qu’absurdes, qui sont un régal pour nos zygomatiques et notre étonnement. Dans des challenges dignes d’une cour de récréation, on assiste ainsi à un concours de corde à sauter, d’équilibre sur les mains, de salto arrière, et d’autres inventions qu’il serait dommage de dévoiler en intégralité. Dans leur créativité et leur talent, ils sont espiègles et irrévérencieux, et on adore ! Le tout avec cette force réservée à certains virtuoses de faire passer pour simples des voltiges époustouflantes et parvenir ainsi à faire battre nos cœurs au rythme de leurs acrobaties aussi vertigineuses qu’originales !
© Steve Ullathorn
A Simple Space, par la Troupe Gravity & Other Myths
Création & interprétation : Gravity and Other Myths
Avec : Lachlan Binns, Jascha Boyce, Joanne Curry, Lachlan Harper, Mieke Lizotte, Simon McClure, Martin Schreiber, Jacob Randell, Lewie West, Elliot Zoerner
Musique : Elliot Zoerner
Avec le soutien de Australia Council
Du 12 au 31 décembre 2023
Du mardi au vendredi à 20h, samedi à 18h et dimanche à 16h
Durée : 1h
Espace Chapiteaux de la Villette
75019 PARIS
Réservations : 01 40 03 75 75
www. lavillette.com
Read More →
Maggie the Cat, de Trajal Harrell à la Grande Halle de la Villette, dans le cadre du Festival d’Automne
// Déc 25th, 2023
© Tristam Kenton
ƒƒƒ article de Nicolas Thevenot
A voir la rampe en fond de scène tel un fil à linge où seraient suspendues jupe à volant, ceintures en tissus, corsets, et autres accessoires rehaussés de pois, rayures ou léopard, à voir les deux tables, sises sous la rampe, débordantes de coussins de velours rouge et taupe, le monde de la mode se destine à entrer en collision avec le monde de la déco dans l’immense salle de la Grande Halle de la Villette. Maggie the Cat est un crash test, auquel on assiste de bout en bout saisi par la puissance spectaculaire et ludique de son bazar qui pourrait presque nous faire oublier sa pertinence dramaturgique. Maggie the Cat déménage, sans même parler des piles de coussins portés à bout de bras. Sous étendard de Tennessee Williams, de sa pièce Cat on a hot tin roof (La chatte sur un toit brûlant en version française), Trajal Harrell chorégraphie un voguing porté par une évidence : il y a du cat dans la pièce de Tennessee Williams, comme il y en a dans la marche des mannequins, ce bien nommé catwalk, élancement puisé dans le déhanchement, comme deux eaux contraires, déployant des corps superbes et indifférents sur le podium des défilés. Avec le sourire malicieux et insolent du bluffeur assénant magistralement sa mise, Trajal Harrell joue cette carte dans une vigoureuse surenchère, exposant encore plus frontalement que dans d’autres créations cet invisible podium, cette parade des fiertés exacerbées, sans pour autant que ne s’estompent les traits de caractère de la pièce de Tennessee Williams. Bien au contraire. C’est comme si ce qui était gros comme une maison, éclipsé dans des sous-entendus criants, invisibilisé sous des draps de lits pour cause de moralité, trouvait ici sa place explicite : en premier lieu, cette dénomination : Maggie the Cat, Maggie la chatte, autant nom de personnage de la pièce que terme fétiche passé dans la culture populaire, concentré de sexualité, de fantasmes, et renvoi à une domestication du plaisir et du désir sous le joug de l’homme. Perle Palombe, ordonnatrice avec Trajal Harrell du grand défilé, endossant le costume de Big Daddy tandis que Trajal Harrell hérite de celui de Big Mama, slame et rappe et vocifère micro en main à tue-tête, effets de saturation garantie, ces quelques mots : Maggie the Cat. Miaulements, trémoussements, roulements de bassins, crissent au sein du ballet réglé des apparences familiales. La chatte, pussycat, comme l’alpha et l’oméga de notre monde capitaliste, consumériste, patriarcal, prédateur et colonialiste. « I want pussycat for my breakfast » hurle Big Daddy. Dans l’hystérie qui gagne ces chattes sur un toit brûlant, les coussins et autres molletons couvrant progressivement les corps participent autant de la contention de la folie que d’un embourgeoisement certain. Convoitise, accumulation de biens matériels comme seule issue aux pulsions sexuelles refreinées. La très grande force de Maggie the Cat est de prendre le parti du contrepied comme pour Tambourine (dernière création de Trajal Harrell) et d’inscrire et construire une jouissance performative, une jouissance spectaculaire, tel un antidote à cette impossibilité à jouir au cœur de l’œuvre de Tennessee Williams. Il fallait oser également, et c’est un bonheur absolu, faire incarner Maggie the Cat par tous ces corps, aussi différents les uns des autres, jusqu’à cela même bien loin des stéréotypes: Maggie the Cat figurée par un bear !
Trajal Harrell crée des pièces enlevées, à tous les sens du terme : de la même façon que les danseurs performeurs attrapent des vêtements et les portent en les détournant, en les retournant, en les déstructurant, Trajal Harrell s’empare de la pièce de Tennessee Williams, la découd, la dépièce, la déporte, la défroque et finalement découvre et exhibe ce que le vêtement dramaturgique recelait de signes escamotés par la primauté de l’histoire. Depuis les serviettes de bain rappelant la plantation de coton à l’origine de la fortune familiale jusqu’aux danses de cheerleader renvoyant au passé de sportif de Brick, tout est là dans cet irrésistible Maggie the Cat quand pourtant rien ne reste d’une narration. Bien loin des discours, bien loin des théories, Trajal Harrell est une pensée critique en acte et en fête.
© Tristam Kenton
Maggie the Cat, chorégraphie, costumes, scénographie et son de Trajal Harrell
Avec : Stephanie Amurao, Helan Boyd Auerbach, Vânia Doutel Vaz, Rob Fordeyn, Trajal Harrell, Christopher Matthews, Nasheeka Nedsreal, Tiran Normanson, Perle Palombe, Songhay Toldon, Ondrej Vidlar
Scénographie : Erik Flatmo, Trajal Harrell
Lumières : Stéfane Perraud
Assistant : Lennart Boyd Schürmann
Dramaturgie : Katinka Deecke
Durée : 50 min
Du 14 au 16 décembre 2023 à 19h sauf samedi 18h
Grande Halle de la Villette
211 Av. Jean Jaurès
75019 Paris
Tél : +33 (0)1 40 03 75 75
https://lavillette.com
Read More →
Un communiqué de presse du SYNDEAC, de Force musicale, SNSP, de PROFEDIM
// Déc 23rd, 2023
LOI IMMIGRATION : CONSTERNATION DU SPECTACLE VIVANT PUBLIC
Paris, le 21 décembre 2023
Suite au vote à l’Assemblée nationale de la loi relative à l’immigration, issue de la commission
mixte paritaire, nous syndicats, associations représentatives du secteur du spectacle vivant,
tenons à faire part au gouvernement, au nom de l’ensemble de nos adhérent.es, de notre
profonde consternation. Nous désapprouvons totalement le contenu de cette loi qui aura, si
elle était appliquée, des conséquences désastreuses dans l’exercice de nos métiers.
Certains articles de cette loi s’opposent directement aux valeurs fondamentales sur la base
desquelles se construit notre politique publique culturelle. L’universalisme de la France, son
ouverture et sa politique d’accueil, son engagement à inclure et à intégrer par le partage des
savoirs, sa constitution qui entend accorder à toutes et à tous de pouvoir accéder aux mêmes
droits, seront grandement remis en cause.
Nous ne pouvons accepter des mesures qui contribueront très concrètement et
inévitablement à un repli de la société française sur elle-même. Nous ne pouvons accepter
que nos étudiantes et étudiants étrangers, accueilli·es au sein de nos écoles supérieures
nationales d’enseignement artistique, se voient soudainement traité·es différemment de
leurs homologues nés sur le territoire français. Nous ne pouvons tolérer qu’ils et elles soient
dans l’obligation de devoir payer – ou réserver – des « cautions financières de retour » afin de
pouvoir intégrer nos écoles et accéder à nos formations. Nous rejetons l’idée d’appliquer de
façon généralisée une majoration des droits d’inscription pour ces étudiantes et étudiants
extra-communautaires. Nous ne pouvons accepter non plus que les artistes et ou
technicien.nes étranger.es, avec lesquel·les nous travaillons, qui intègrent les distributions de
nos spectacles, n’aient pas les mêmes droits sociaux que leurs collègues, au nom d’une
intolérable « préférence nationale ». Cette idée empruntée à l’extrême-droite est totalement
antinomique avec l’idée de produire des œuvres qui se nourrissent précisément de l’échange
et de la rencontre avec l’autre. Quant à la spécificité de l’emploi artistique, et notamment sa
discontinuité, elle rendra quasiment impossible l’intégration par le travail et l’accession à
l’ouverture de droits sociaux minimaux. L’engagement de nos lieux d’arts et de culture, dans
l’accueil des artistes en situation d’exil et demandeurs d’asiles politiques, comme ce fût
récemment le cas avec le retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan, ou suite à l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, risque également d’être empêché par l’application de cette nouvelle
loi.
Au quotidien, dans l’exercice de nos missions de service public, nous oeuvrons à rassembler,
sans aucune distinction d’origines sociales ou géographiques ni même de statut administratif.
Nous travaillons, jour après jour, dans le cadre des droits culturels, à permettre une égalité
d’accès à toutes et tous aux propositions artistiques qu’offre notre pays. Il est inimaginable
que notre action sur le terrain, puisse être entravée par l’application d’une loi qui emprunte
nombre de ses articles au programme de partis politiques extrémistes, que nous sommes par
ailleurs engagé·es à combattre, tant la banalisation de leur idéologie contrevient aux valeurs
humanistes qui sont les nôtres. L’image de la France, telle que notre vitalité artistique et
culturelle a contribué à la construire aux yeux du monde entier, en serait profondément
dégradée.
La France, dans son histoire, a accueilli des milliers d’artistes étranger·es sur son sol, qui eux
mêmes ont enrichi notre culture. L’identité et la culture françaises ne sont pas figées. Elles
vivent et se transforment significativement et positivement grâce à notre politique d’accueil
et d’intégration. C’est pourquoi nous appelons à une mobilisation massive contre l’entrée en
vigueur de cette loi, qui porte gravement atteinte aux droits des étranger·es en France.
Autres signataires :
ACCN · Association des centres chorégraphiques nationaux
A-CDCN · Association des centres de développement chorégraphique nationaux
ACDN · Association des centres dramatiques nationaux
A-Cnarep Association des centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public
ASN · Association des scènes nationales
FASAP-FO · Fédération des arts, du spectacle, de l’audiovisuel et de la presse
Fevis · Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés
France festivals
Fédération Communication Conseil Culture CFDT
Territoires de cirque
Syndicat national des Musiciens et du Monde de la Musique – Force Ouvrière
Syndicat national libre des artistes – Force ouvrière
SYNDEAC
Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles
20 rue Saint-Nicolas · 75012 PARIS
0144537210 · www.syndeac.org
Read More →
Austerlitz, de Gaëlle Bourges, au Carreau du temple, Paris
// Déc 22nd, 2023
© Danielle Voirin
ƒ article de Nicolas Thevenot
Austerlitz, c’est une gare à Paris, c’est une bataille napoléonienne qui a donné son nom à une gare, et c’est le titre d’un vertigineux roman de W. G. Sebald. Comme pour Les émigrants, prochainement visible dans une adaptation et mise en scène de Krystian Lupa à l’Odéon, l’écriture se fait lieu du surgissement de la mémoire, construisant patiemment et sensiblement par avancées circonvolutives une histoire humaine sans cela vouée à un irrémédiable effacement. Une histoire dont les lettres lumineuses de son écriture se détachent dans l’ombre des crimes de masse du XXème siècle. Si Les émigrants renvoie au récit minutieusement forgé à partir d’archives et est basé exclusivement sur des faits et personnes réels, Austerlitz en est le versant romanesque sans rien perdre de l’acuité du précédent. Les deux font partie de ces lectures qui marquent une vie.
Gaëlle Bourges ne s’empare pas du livre proprement dit mais du procédé d’écriture qui le meut : une narration qui progresse à force de digressions, de découvertes, de hasards, creusant comme un archéologue ce qui affleure du passé dans le contemporain, et ainsi remontant, à la manière d’un rhizome, jusqu’à l’origine du personnage éponyme du roman de Sebald. Puisant dans la matière mémorielle des danseurs, dans la sienne, Gaëlle Bourges produit un texte à la fois linéaire et spiralé, s’étendant sur plusieurs continents et à travers différentes époques. Filiations artistiques en premier lieu, notamment dans le champ de la danse contemporaine, mais aussi histoires de famille embrassant les deux guerres et celle d’Algérie. Les mots tissent leur toile d’araignée, des raccourcis se forment entre plusieurs histoires, lieux, ou personnes, rejoignant en cela ce qui faisait la force épiphanique du roman de Sebald. Gaëlle Bourges tapisse également cette matière documentaire de l’étoffe des rêves qui la traversent pendant la préparation de son projet. La scène est visible à travers une gaze tendue sur toute l’ouverture du plateau produisant un effet de lointain et de floutage selon le jeu des lumières. En fond de scène, à jardin, un espace de projection se fait le réceptacle de photos d’époque en lien avec le récit. Les danseurs apparaissent succinctement à la manière de flashs : moments découpés, stylisés, chorégraphiés au millimètre. Las, très vite on se sent expulsé et spectateur passif, désactivé, d’une proposition qui tourne au système et semble dans sa réalisation, dans sa phénoménologie, tourner le dos au geste de Sebald et nous tenir fermement à distance. La voix enregistrée confond la fermeture avec l’épure, annihilant toute possibilité polysémique, les mots au lieu de faire écho comme des ronds dans l’eau nous arrivent forclos. La perfection des mouvements chorégraphiés renvoie à une mémoire lissée, idéalisée, singulièrement dévitalisée et aboutit à une simple illustration d’un propos. Austerlitz affiche dans sa fabrication tous les signes qui renvoient à une idée de la mémoire, mais ne sauraient être une mémoire en jeu. La mémoire est imparfaite, flottante, et surtout elle semble se partager dans le tremblement d’une absence. C’est en cela qu’elle est force d’émotion, puissance d’agir dans le présent. La déception est à la mesure de la constellation des noms égrenés façon name droping de tous ceux qui ont fait l’histoire de l’art, d’Aby Warburg à Antonin Artaud, en passant par Steve Paxton, Emily Dickinson, et Brecht.
© Danielle Voirin
Austerlitz, conception et récit de Gaëlle Bourges
Avec : Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Camille Gerbeau, Stéphane Monteiro, Alice Roland, Pauline Tremblay & Marco Villari
Accessoires : Gaëlle Bourges et Anne Dessertine
Costumes : Anne Dessertine
Chant : tou·te·s les performeur·euse·s + KrYstian
Images projetées : archives (personnelles et autres)
Lumières : Maureen Sizun Vom Dorp
Musiques : KrYstian & Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK
Régie générale : Stéphane Monteiro
Régie son : Michel Assier-Andrieu
Durée : 1h30
Du 13 au 14 décembre 2023 à 19h30
Carreau du Temple
2 Rue Perrée
75003 Paris
Tél : 01 83 81 93 30
https://www.lecarreaudutemple.eu
Du 18 au 30 janvier 2024
Théâtre Public de Montreuil – CDN
Du 13 au 14 février 2024
Maison de la Culture d’Amiens
Le 1er mars 2024
Théâtre Antoine Vitez
Ivry-sur-Seine
Du 5 au 7 mars 2024
Théâtre de la Vignette
Montpellier
Read More →

© Hans Gerritsen
ƒƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia
Le Grimaldi Forum de Monaco et les Ballets de Monte-Carlo proposent en cette fin d’année 2023 une soirée Ravel, comme un dernier hommage au centenaire de la naissance du Prince Rainier III qui affectionnait particulièrement la seconde des deux œuvres du compositeur, présentées dans leurs versions de ballet.
La Valse initialement conçue comme un poème chorégraphique pour piano seul, serait ces dernières années l’œuvre de musique classique la plus jouée dans le monde, dans sa version d’origine ou d’orchestre. Ravel avait souhaité dès le départ qu’elle soit dansée par les Ballets russes, mais Diaghilev opposa une fin de non-recevoir en dépit des discussions préalables à la Première guerre mondiale et de l’entremise de leur amie commune Misia en 1920 à laquelle il avait dédié sa composition. Ce n’est qu’une trentaine d’années plus tard que George Balanchine la chorégraphia à New-York, où elle fut créée en 1951 au City Center of Music and Drama. C’est cette chorégraphie entrée au Répertoire en 1975, qui est dansée par les Ballets de Monte-Carlo. Il s’agit d’un ballet néoclassique au sens propre et très classique au sens figuré, qui met en valeur traditionnellement les danseuses plutôt que les danseurs, dans des tenues scintillantes et longs gants blancs assez convenus et un décor minimaliste néanmoins très joliment éclairé. Aucune surprise ne surgit vraiment, mais l’ensemble est bien exécuté et les 90 musiciens de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo très enjoués sous la baguette de David Molard Soriano.
C’est la seconde œuvre de Ravel qui fait tout l’intérêt et la joie de cette soirée à Monaco. C’est d’ailleurs en son Opéra que L’Enfant et les sortilèges composée peu après La Valse, fut représenté pour la première fois, et non à Paris comme initialement prévu en 1925. Cette pièce opératique, généralement qualifiée de fantaisie lyrique, est en soi un petit bijou vocal que l’on a toujours autant plaisir à écouter, en compagnie ou non de jeunes auditeurs. Le livret écrit par Colette peut être perçu comme un brin moralisateur, mais la chorégraphie de Jean-Christophe Maillot, qui est une recréation d’une première version (de 1992) lui donne la distance nécessaire en valorisant en quelques sortes l’apprentissage de l’enfant, lequel renâcle à faire ses devoirs (le fameux air « J’ai pas envie de faire ma page »), ce qui suscite les réprimandes de ses parents et en retour une colère qui se déverse sur tout ce qui est à sa portée. Le chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo, accompagné par les décors et costumes sublimes de Jérôme Kaplan, s’est emparé du récit qui met en scène la rébellion des objets et animaux tourmentés dans une sorte de cauchemar éveillé venant faire prendre conscience à l’Enfant, dansé par la délicate et gracile Ashley Krauhaus, de la gratuité de sa méchanceté passée et provoquer la découverte progressive de la différence entre le bien et le mal et in fine de l’empathie pour un écureuil blessé (« Il a pansé la plaie, étanché le sang ») et du retour à l’amour maternel (« Maman » est le dernier mot prononcé). Le chorégraphe a également eu l’audace d’ajouter en une sorte de prologue d’environ deux minutes, avant le Prélude, le tic-tac d’une horloge (présente dans l’irrésistible quatrième scène du « ding, ding, ding et encore ding… je ne peux plus m’arrêter de sonner ») qui vient introduire l’univers onirique du spectacle.
Les chanteurs solistes placés en bord de scène à jardin, viennent en sous-texte des tableaux tous plus enchanteurs les uns que les autres qui se succèdent à grande vitesse sur la scène du Grimaldi Forum, tandis que les cent choristes placés au balcon, à jardin et à cour, surprennent le public dès leur première intervention, et que le Chœur d’enfants (de l’Académie de musique et Théâtre Rainier III) en petites marinières émeut. On soulignera parmi les solistes en particulier les belles prestations des mezzo-soprano Cécile Madelin (l’Enfant) et Axelle Saint-Cirel (la Mère notamment).
Les duos de chats, trio de batraciens (au sein duquel, musicalement, s’insère une citation de la partition de La Valse entendue avant l’entracte), ensemble de tasses et théière, oiseaux et l’Arithmétique en personne sont quelques-uns des personnages dansés (et chantés en miroir) par une cinquantaine de danseuses et danseurs s’épanouissant incontestablement dans ce registre qui dispute la fantaisie à la technique. Une allégresse et énergie éclatantes se transmettent du plateau à la salle et on ressort, des paillettes plein les yeux, avec la sensation d’être revenue à son âme émerveillée d’enfant le temps d’une soirée magique à Monaco.
© Hans Gerritsen
La Valse, chorégraphie de George Balanchine
Musique : Maurice Ravel
Costumes : Karinska
Décors : Jean Rosenthal
Lumières : Mark Stanley
Durée : 30mn
L’Enfant et les sortilèges, chorégraphie : Jean-Christophe Maillot
Musique : Maurice Ravel
Livret : Colette
Assistant chorégraphe : Bernice Coppieters
Costumes et décors : Jérôme Kaplan
Lumières : Dominique Drillot
Vidéo : Loïc Van der Heyden
Dessins originaux : Ines Reddah
Perruquier : Sky Flores
Durée 45 mn
Grimaldi Forum
Salle des Princes
10 Avenue de la Princesse Grace
Monaco
Jusqu’au 23 décembre 2023
19h30
www.balletsdemontecarlo.com
Read More →
Funkenstein, de Kidows Kim, à la Ménagerie de verre, Paris, dans le cadre du festival INACCOUTUMÉS 2023
// Déc 19th, 2023
© Lucille Belland
ƒƒƒ article de Nicolas Thevenot
Les performances de Kidows Kim dressent, pièce après pièce, une cosmologie inouïe dont les créatures extraordinaires, renouvelées et préexistantes, déploieraient d’autres manières d’être vivant, d’articuler espace et temps. L’effet de sidération est son principal fait, comme la découverte de nouvelles planètes dans une galaxie inconnue qui n’en finirait pas de produire ses avatars. Et c’est toujours à une sorte de révolution, au sens autant astronomique qu’artistique, à laquelle on assiste. Le temps suspend ici étrangement son vol pour s’effondrer dans un corps concaténant d’infimes pulsions. La notion même de spectacle performatif est mise à mal tant il s’agirait presque d’expérimentation biologique d’organismes mutants. La pleine conscience s’abime dans le désordre d’un nouvel ordre. Le bestiaire proposé par Kidows Kim de performance en performance se construit de bric et de broc, dans un dénuement et un rafistolage baroque, au croisement de l’intimité la plus engoncée d’un être enfoui dans une corporéité fantastique déviant des règles du « bien vivre », et d’un univers en perpétuel expansion. C’est un plein et un vide, une superposition de perceptions quantiques pour le spectateur, tant la performance conjugue les opposés du spectaculaire.
Les chaises sont disposées en deux lignes courbes formant une amande, un œil bridé. Au centre Kidows Kim, replié sur lui-même au sol, tête masquée sous un collant marron, traits du visage gommés, deux nattes formées par les jambes de la résille régulièrement nouée, coulant le long du corps. La forme monstrueuse se condense en un tronc vêtu d’un tee-shirt auquel s’agglomèrent une nuisette noire et d’autres vêtement encore, pendouillant. Hors de ce tronc, tout ne semble qu’appendices, membres imparfaitement développés. Les doigts s’agitent telles les têtes de la méduse. C’est une communication inconnue, secrète et secrétée, qui s’établit entre la périphérie et le centre, comme des parties disjointes en pleine découverte et reconnaissance mutuelle. Dans une bascule mettant cul en l’air, jambes affaissées, le slip kangourou blanc fait apparaître de manière surprenante et comique un buste humain, sans tête, deux larges épaules formées par les cuisses pendantes : Kidows Kim prend racine dans le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Circonvoluant sur elle-même, la créature comme offerte au regard sur un plateau de dissection extirpera deux baguettes chinoises et entreprendra d’attraper à travers un trou opportunément percé dans l‘entrejambe du slip dit kangourou, la peau de la racine d’un sexe. Nous catapultant dans une étrangeté toute surréaliste, une sorte de dérision germine entre les mots et les corps, car à quoi d’autre pourraient servir ces baguettes qu’attraper une nouille ? A moins qu’il ne s’agisse d’évoquer les sophistiqués bras robotiques opérés dans les stations spatiales… A sa façon économe, Funkenstein peut ainsi s’envisager comme un space opera, ce que ne démentiraient pas les mélopées lyriques que produira la créature de Kidows Kim au moment de disparaître. Avant de quitter la salle de la Ménagerie de verre, j’ouvre le Fortune cookie trouvé sur ma chaise à mon arrivée : Be good or be good at something. J’espère l’avoir été.
© Lucille Belland
Funkenstein, création et performance de Kidows Kim
Collaboration costume : Josiane Martinho
Accompagnement artistique : Lucille Belland
Régie générale : Marie Sol Kim
Dialogue artistique Pauline L.Boulba, DD Dorviller, Kazuki Fujita, Myrto Katsiki, Jennifer Lacey, Anne Kerzerho, Fuyuhiko Takata et cohue.
Durée : 25 minutes
8 et 9 décembre 2023, vendredi à 19h et samedi à 18h
Ménagerie de verre
12/14 rue Léchevin
75011 Paris
Tel : 01 43 38 33 44
https://www.menagerie-de-verre.org
Read More →
Copyright © 2009 Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales parisien.
All rights reserved.


 Billet des Auteurs de Theatre
Billet des Auteurs de Theatre Editions Mandarines
Editions Mandarines Paroles francophones
Paroles francophones Théâtre du Rond Point
Théâtre du Rond Point