« Les Recluses » de Koffi Kwahulé
// Jan 23rd, 2010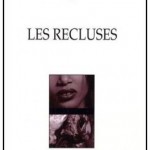
Lecture d’Hervé Mestron –
sont des femmes victimes de violences sexuelles qui se réunissent clandestinement pour témoigner et se soigner par le théâtre. Le groupe est animé par un étrange et invisible personnage qu’elles nomment «celui qui est parti, qui n’est jamais arrivé et qui est revenu».
Kaniosha, la plus jeune d’entre elles, doit quitter le groupe. Elle va se marier et craint que son futur mari découvre sa «souillure» et remette en question le mariage. Son voisin, un juge récemment revenu de l’étranger, découvre son secret qu’il promet de taire contre des relations intimes…
Koffi Kwahulé a décidé d’offrir un destin à ces recluses. Dès le départ, il les place en position de travail, de parole. Le tabou va lentement s’estomper grâce à cette volonté de dire. C’est un principe de résilience porté par les mots, où les masques tombent, où la fatalité est une musique à combattre, l’abus de pouvoir un trou béant à combler.
Les situations de guerre sont le théâtre des horreurs humaines. Au delà du principe de conflit, ce sont les populations civiles qui paient, surtout les femmes, comme si les hommes avaient besoin d’inscrire dans la chair innocente le fruit de leur dérive mentale.
L’écriture de Koffi Kwahulé est lumineuse, sensuelle, et toujours teintée d’humour pour amortir les chocs. Un grand texte, composant avec l’universel.
Les Recluses est une commande du Théâtre Varia de Bruxelles et a été créé (en kirundi : le Kirundi ou langue rundi, est une langue bantoue parlée au Burundi par toute la population, dans les zones adjacentes de Tanzanie et de la République démocratique du Congo, ainsi qu’en Ouganda, ce qui totalise plus de 6 millions de personnes), le 22 mai 2009 à Bujumbura, au Burundi, dans une mise en scène de Denis Mpunga, puis reprise à Bruxelles à l’automne 2009.
Les Recluses
De Koffi Kwahulé
Editions Théâtrales
20 rue Voltaire, 93100 Montreuil
www.editionstheatrales.fr
Read More →
« Yaacobi et Leidental » de Hanokh Levin
// Jan 23rd, 2010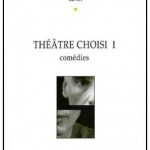
Lecture de Bruno Deslot –
La quête du bonheur illusoire
La quarantaine et une envie folle de tenter l’expérience du bonheur, Yaacobi décide de quitter son ami de toujours, David Leidental, pour se donner à la vie à corps perdu.
Une amitié fusionnelle, entre Itamar Yaacobi et David Leidental, les mène jusqu’à l’aube de leurs quarante ans, mais réveillé par la vie, Yaacobi, décide de partir à la quête du bonheur, laissant derrière lui, un ami pourtant si proche. Ainsi, débute cette folle épopée, dans laquelle Yaacobi se jette aveuglément, croyant que sa représentation du bonheur idéal existe. Il rencontre Ruth Chahach, une chanteuse de parade aux formes généreuses, dont l’âme toute entière est vouée à la musique. L’improbable rencontre est effective, le bonheur semble donc bien réel et Yaacobi s’en persuade en tombant amoureux de cette musicienne en devenir. Le mariage fera donc partie de ce monument de tartufferie auquel Itamar participe activement afin de donner toujours plus de légitimité à sa quête illusoire du bonheur. Mais Leidental, abandonné par son ami de toujours, s’arrime au quotidien de Yaacobi afin de connaître, lui aussi, cette existence fantasmée. S’offrant en cadeau de mariage aux jeunes époux, l’union est scellée devant l’autel de l’illusion. Le temps passe et l’euphorie de l’union cède sa place au poids étouffant du quotidien, au point de faire regretter à Yaacobi les temps bénis du passé des parties de dominos avec son meilleur ami. Entre hésitations, existence mal aisée, déception et férocité, la question du bonheur s’impose au chaos infernal des aspirations frustrées des trois personnages qui passent plus de temps à parler d’eux-mêmes qu’à se réaliser vraiment. L’acte peut être accompli mais porte toujours le poids douloureux du regret et de l’ennui.
Une farce incisive
Yaacobi et Leidental est une comédie construite en 30 tableaux qui mêlent dialogues incisifs, chansons, apartés et adresses au public oscillant entre effets burlesques et situations banales. Hanokh Levin utilise le rire, souvent féroce, pour dépouiller ses personnages pris dans le combat quotidien de l’existence. Entre la pensée et la farce, un discours très violent et ironique s’immisce dans les interstices d’un texte construit comme une vaste fresque épique et trépidante mettant en lumière une déclinaison de l’impuissance à vivre sans l’angoisse prégnante d’un idéal illusoire. Comment changer « sa vie » pour laisser une trace honorable de son passage sur terre ? Une question à laquelle la pièce ne propose aucune réponse, mais par un jeu de miroir, les trois anti-héros semblent nous renvoyer à nos propres questionnements qui, mis à distance, sont bien souvent caustiques et ridicules. Yaacobi et Leidental témoigne d’une puissante liberté d’expression de la part de son auteur et personne n’échappe à son jugement acéré.
La pièce Yaacobi et Leidental sera représentée du 19 janvier au 21 février 2010 au Théâtre du Rond Point à Paris (voir ici).
Yaacobi et Leidental
De Hanokh Levin
Traduit par Laurence Sendrowicz
Editions Théâtrales
20 rue Voltaire, 93100 Montreuil
www.editionstheatrales.fr
Voir aussi :
La pièce Yaacobi et Leidental
Read More →
« Philoctète & Ravachol » de Cédric Demangeot à la Maison de la Poésie
// Jan 23rd, 2010
Critique de Bruno Deslot –
Deux destins malheureux
Héritier des armes divines, livrées par Héraklès, Philoctète est le dépositaire de l’arc et des flèches sans lesquels Troie ne peut être prise. Philoctète invincible, mais aussi blessé et incurable, n’a jamais pardonné aux Grecs, dont Ulysse, de l’avoir abandonné neuf ans plus tôt sur une île déserte, pour ne plus avoir à supporter ses hurlements et la puanteur de sa plaie. Voilà un homme humilié par la souffrance, livré par son propre camp à une solitude absolue, et qui, neuf ans après, ne revoit les visages de ses semblables que pour être à nouveau trahi. Mais dans le poème de Cédric Demangeot, Philoctète refuse de confier à Ulysse, l’arc d’Héraklès et surtout de revenir à Troie. Il crie sa haine des Grecs et choisit de rester seul sur son île, une situation d’exclusion qui lui fait connaître la vie. Figure de résistance aux yeux des Grecs au « corps glorieux » et au destin de Vainqueurs, Philoctète converse avec « la vraie » vie de manière rimbaldienne tout comme Ravachol dont l’auteur tente d’interroger la figure si controversée à la lumière d’un dialogue d’une profonde humanité. Célèbre anarchiste français, mort guillotiné à l’âge de 33 ans en 1892, Ravachol « le terroriste » ayant commis des crimes de droit commun, rendu célèbre par son action militante et sa déclaration politique au procès de Montbrison, se raconte, s’offre au public dans un échange intime d’une grande intensité.
Une profonde leçon d’humanité
Patrick Zuzalla met en vis à vis le personnage mythologique et l’anarchiste français dans un nihilisme destructeur qui s’achemine vers toujours plus d’humanité. Images paradoxales et pourtant si proches de deux personnages pour lesquels l’auteur, Cédric Demangeot, brise le mythe afin d’interroger l’homme, les hommes dont le destin s’inscrit aux confins de l’exclusion. Deux poèmes en vers, ravachol et Philoctète, qui s’enchaînent pour dire tout ce qui leur est possible de dire dans un dialogue d’une étonnante contemporanéité, faisant résonner la vie intérieure du mythe pour mieux l’humaniser. Deux corps en mouvement, marqués du sceau de la société dont ils ne veulent pas, s’animent et exhalent l’odeur putride de leur souffrance, la vérité de leur combat, la force de leur engagement dans une résistance éprouvée. Composé d’une succession de points de vue, expurgeant la parole de Ravachol dans une enquête lyrique et associant celle de Philoctète dans une version résolument furieuse, le poème de Demangeot expose la solitude de deux personnages. Patrick Zuzalla s’approprie l’image de ces deux figures de résistance pour mettre en abîme un questionnement sans concessions sur la condition humaine. Il réussit à faire entendre et à donner du sens à chaque vers en recourant, par la voix et le corps de Damien Houssier, à un strict respect du rythme prosodique de la composition poétique de l’auteur. Chaque stance est porté en gloire par une musicalité aux tonalités wagnériennes retentissant dans un univers beckettien. Seul en scène, Damien Houssier, évolue avec force dans un espace clos auquel il donne toujours plus de perspective en recourant à une mise en voix poignante et puissante d’un texte exigeant. Son corps en action, incarne le sens profond de chaque vers en libérant la mélodie dévastatrice de la douleur. Construisant son ouvrage dans un dialogue de proximité avec le public, il se livre avec une pudeur et une élégance saisissantes. Jeune homme au col blanc et amidonné, il est Ravachol, ouvrier teinturier apprenti, se souvenant de son enfance passée à la ferme. Une voix secrète s’immisce dans l’univers dépouillé de son passé de jeune homme pour gagner en intensité dès lors qu’il s’empare de la marmite, boite de Pandore, qu’il ouvre inlassablement afin de répandre le sang dont il finira par être maculé. Nu, détaché de toutes conventions sociales, il expose l’indécence de sa pensée dont sa chair se fait l’écho. Damien Houssier incarne la dimension charnelle de son personnage avec un talent et un engagement déconcertants. S’offrant à son destin, s’abandonnant à la réalité de sa condition, il se roule, s’allonge, s’arrime à une bâche maculée de sang pour se relever avec force et dignité et porter la douleur extrême de Philoctète, dont la jambe gangrenée devient le symbole de la « vraie » vie. Les variations de l’œuvre basculent dans un lyrisme enchanteur dont le comédien se saisit pour lui accorder une sensibilité particulièrement attachante. Il offre une puissance dramatique à l’ensemble de la proposition tellement talentueuse que l’on oublie vite cette transition, qui ne fonctionne pas, dans la manière de passer de Ravachol à Philoctète en ne recourant qu’au symbole évident de la jambe malade du personnage mythique. Philoctète & ravachol, un spectacle fort, puissant et saisissant auquel Damien Houssier donne ses lettres de noblesse par son talent qui relève de l’exception.
Philoctète & Ravachol
De : Cédric Demangeot
Mise en scène et scénographie : Patrick Zuzalla
Assistante à la mise en scène et création lumière : Emmanuelle Phelippeau-Viallard
Costumes : Anne Terzian
Son : Florent Dalmas
Vidéo : Xavier Bonin
Musique : Rolf Riehm et Carlo Rustichelli
Avec : Damien Houssier
Du 20 janvier au 14 février 2010
Maison de la Poésie
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75 003 Paris
www.maisondelapoesieparis.com
Voir aussi :
La rencontre avec le metteur en scène Patrick Zuzalla
Read More →
Critique • « La Menzogna » de Pippo Delbono au Théâtre du Rond-Point
// Jan 22nd, 2010
Critique de Camille Hazard –
« L’art est un mensonge qui permet de dévoiler la vérité »
Voilà ce que Disait Pablo Picasso
Dans le nouveau spectacle de Pippo Delbono, La Menzogna, il conviendrait plutôt de conclure que « l’art est un mensonge qui permet de révéler le mensonge » !
Voilà la grande thématique de cette nouvelle création : le Mensonge dans tous ses états.
Artiste engagé, admirateur de P.P.Pasolini et de F.G.Lorca, Delbono nous avait habitué à des spectacles de très grande qualité ; autant dans la forme que dans le fond, traitant de thèmes fondamentaux et universels comme le pouvoir, la domination, la dictature, la guerre, l’enfermement, l’obscurité, l’exode, l’image que l’on renvoie et que l’on perçoit… Sa troupe, constituée d’acteurs professionnels, prodigieux dans le corps et dans la voix, ainsi que de Bobò, un sourd, muet, microcéphale resté 50 ans dans un hôpital psychiatrique et Gianluca, un trisomique, offre une technicité en même temps qu’une vérité sur scène saisissante !
La magie de ces spectacles résidait dans la force de ses propos et dans la facilité à les appréhender ; conduits sous forme de tableaux, les prises de consciences, les questions amenées sur scène nous arrivaient en plein visage, sans que l’on puisse s’y dérober. Comme si une main paternelle et généreuse nous ouvrait les yeux, les oreilles et que nous, enfants, restions bouche bée devant ces spectacles illuminés d’horreur et de poésie.
Quelles furent donc la surprise et la déception en voyant La Menzogna. Pippo Delbono, ne pose plus de questions, il affirme des propos pour le moins démagogiques, comme pour n’en citer qu’un, mais qui est de taille : Les riches sont méchants, les pauvres sont gentils !
Incendie ravageur
Le spectacle tourne donc autour du Mensonge : le mensonge des médias, le mensonge des politiciens, le mensonge de l’église, le mensonge du spectacle, le mensonge que l’on porte en nous…
À la fin du spectacle, P.Delbono se présente face à nous, entièrement nu, pour s’excuser du mensonge qui réside dans sa représentation artistique.
Le point de départ de ce travail est l’accident survenu à l’usine Thyssen Krupp de Turin l’année dernière ; la vétusté des machines a déclenché un incendie, provoquant la mort de sept ouvriers.
Tous les médias se sont précipités sur le lieu du drame, diffusant des images de familles de victimes qui pleuraient et hurlaient dans les décombres. « Du pathétique pris en sandwich entre deux publicités » comme le dit P.Delbono.
On demande aux gens de s’apitoyer sur ces images, mais personne ne s’intéresse à la question : Comment aurait on pu éviter ce drame ?
Dans le cas de l’usine Thyssen Krupp, il aurait suffit de mettre aux normes quelques machines pour préserver des vies humaines !
Mise en scène
Une partie de l’usine est reproduite sur scène : échafaudages, rampes, casiers pour les affaires des ouvriers, grillages… Le tout ordonné méticuleusement.
Le spectacle commence ; quelques ouvriers arrivent, se changent, partent travailler. Aucun personnage ne parle, le temps est étiré, on a le sentiment que quelque chose de fort se prépare…Mais rien n’arrive, la tension retombe. Sur ce, P.Delbono lance au public « Messieurs dames, nous allons faire une petite pause, restez assis ».
Mais nous aurions souhaité tout simplement qu’il commence !
La représentation reprend ; une soirée entre riches patrons, femmes débridées, curés corrompus. Delbono, tour à tour, leur donne la parole : ils vocifèrent, aboient, hurlent comme des furies sorties tout droit de l’enfer. À la fin de cette soirée, le metteur en scène appuie le trait en exposant Gianluca nu avec des colliers de perles, chantant et dansant.
Nous avons eu des images fortes d’autres spectacles où Gianluca égayait la scène par sa fraîcheur ; là nous chavirons entre le voyeurisme et la pitié tant sa nudité est gratuite.
Puis l’incendie se déclenche dans l’usine, quelques corps nus d’acteurs tentent d’illustrer la douleur des flammes, mais là encore : simple amorce, rien ne nous atteint, ni l’angoisse, ni la douleur, ni la mort.
Au fil des tableaux, Gianluca et Bobò arpentent la scène tour à tour, l’un miaulant délicatement, l’autre sourd et muet.
Puis la fin du spectacle arrive, Delbono se déshabille face à nous, s’excuse puis se couche dans le fond de la scène. Bobò revient, marche pendant que la voix du maître de cérémonie (P.Delbono ) s’élève nous confiant : « Parfois j’aimerai être comme Bobò sourd, muet, microcéphale et être pure » Dans cette phrase il semble complètement nier la vie qui lui a été donné et se montre bien égocentrique !
Le spectacle est fini.
On aura attendu les émotions, les éléments perturbateurs, le jeu…En vain.
Le corps des acteurs n’est cette fois pas exploité, Delbono reprend des éléments communs à ses précédents spectacles (la lampe de poche qui éclaire le public, les hurlements déchaînés, les corps nus…) mais avec la plus parfaite gratuité.
La scénographie de Claude Santerre est minutieuse et esthétique, mais ne reste qu’une enveloppe vide.
Nous attendons la prochaine création de Pippo Delbono avec impatience et voulons croire que La Menzogna restera à part dans son œuvre.
La Menzogna
Idée et mise en scène : Pippo Delbono
Avec : Dolly Albertin, Gianluca Ballaré, Raffaella Banchelli, Bobò, Julia Morawietz, Pippo Delbono, Lucia della Ferrera, Ilaria Distante, Claudio Gasparotto, Gustavo Giacosa, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Mr. Puma, Pepe Robledo, Antonella de Sarno, Grazia Spinella
Scénographie : Claude Santerre
Lumières : Robert John Restinghini
Costumes : Antonella Cannarozzi
Organisation : Christian Leblanc et Emilia Romagna Teatro
Du 20 janvier au 6 février 2010
Théâtre du Rond-Point
2 bis rue D.Franklin Roosevelt, 75 008 Paris
www.theatredurondpoint.fr
Voir aussi :
La rencontre avec l’auteur Pippo Delbono
Read More →
« Le Roi Nu » d’Evguéni Schwartz dans une mise en scène de Philippe Awat à la Tempête
// Jan 21st, 2010
Critique de Bruno Deslot –
La fable du despotisme
Une libre adaptation, de trois contes d’Andersen, pour dénoncer le conformisme et la terreur d’un pouvoir politique particulièrement coercitif.
Le Porcher amoureux, La Princesse au petit pois et Les Habits neufs de l’empereur, trois contes d’Andersen, inspirent Evguéni Schwartz pour écrire Le Roi nu, une fable politique exhalant un esprit de franche sédition. Sous le joug d’un père autoritaire, une jolie princesse se fait courtiser par un jeune porcher épris de la demoiselle. Mais le Roi, s’oppose fermement à cette union car il a bien d’autres projets pour sa fille. Il décide de la marier à un vieux barbon couronné, cruel et coquet, un roi d’un état voisin, dictateur tyrannique et fanatique. Obsédé par la pureté du sang, il poursuit ses sujets, un poignard à la main. Bien heureusement, Henri, le jeune porcher, et son compère Christian, se déguisent en tisserands pour proposer au roi une étoffe merveilleuse, invisible aux yeux des traîtres et des imbéciles. Aussitôt, celui-ci leur commande un vêtement pour sa noce.
L’univers grotesque de la farce
Auteur d’une douzaine de pièces pour enfants en forme de contes et des pièces pour marionnettes, Evguéni Schwartz (1896-1958) utilise, dès 1934, ce procédé pour s’adresser aux adultes. Recourant à la farce, l’auteur tente de dissimuler ses prises de positions politiques dans un genre qui lui semble difficilement condamnable. Mais l’intrigue déchaîne les foudres de la censure soviétique qui interdit la représentation du Roi nu, avant même que cette pièce soit portée à la scène, elle ne sera présentée que 23 ans plus tard, au public soviétique. Sujétion de l’individu, tyrannie exercée par les régimes totalitaires, terreur imposée par un régime politique coercitif, les thèmes sont traités avec une apparente légèreté mais ne font que dissimuler une situation grave et alarmante d’un pays, la Russie, qui mène une véritable course vers l’abîme. On a souvent pensé que Le Roi nu incarnait la figure de Joseph Staline, mais le propos incisif et autoritaire de la pièce, rappelle de toute évidence celle d’Adolphe Hitler dans sa quête improbable d’une race pure et l’affirmation d’un fanatisme dévastateur. Pour raconter ses fables, l’auteur choisit des héros qui incarnent la résistance et la lutte contre le pouvoir en place sur un ton toujours plus ironique. Henri le porcher et son ami Christian, déjouent les codes pernicieux d’une société que la terreur légitime. Habiles, moqueurs et tenaces, ils apportent un point de vue éclairé sur un régime dont on ne peut que faire le procès.
Philippe Awat a pris le parti d’aborder Le Roi nu dans sa dimension farcesque, voire grotesque pour proposer une mise en scène rythmée, colorée et résolument burlesque. L’univers politique est évincé au profit d’une lecture tout particulièrement comique de la pièce. Le rideau se lève sur une farandole de personnages atypiques, s’animant sur le plateau comme les marionnettes d’un théâtre pour enfants. Libéré de toutes contraintes scénographiques, l’espace est utilisé avec une précision étonnante et permet aux comédiens d’arpenter les chemins du grotesque dans une course assurément haletante. Jeu acrobatique, lorsque Henri entre en scène pour énoncer la situation initiale du récit, danses rythmées et cadencées quand la marmite de Christian fait résonner les tonalités d’une musique entraînante, les personnages se croisent, se rencontrent, se heurtent les uns aux autres comme les pions d’un échiquier sur lequel la partie engagée, serait perdue d’avance. Un sol blanc, recouvre le plateau sur lequel deux structures, l’une rectangulaire, l’autre en escalier, offre un point de fuite vers lequel tout bascule. La perspective est accentuée par un remarquable jeu de lumières qui donne toujours plus de profondeur à un univers fantasmé. D’un côté, un élément en accordéon, d’où sortent les têtes affamées des porcs dont Henri à la charge, constitue un lieu de passage obligé pour les gens du peuple. Les escaliers, hauts et larges, imposent une démarche altière à ceux qui les parcourent, une belle opposition qui file la métaphore du pouvoir. Le décor est suggéré par les lumières qui portent ombrage à la pâleur d’un fond de scène présenté comme un écran, dont la toile se déchire pour libérer les personnages qui y sont projetés. Entre habits de soleil ou couleur de lune, Peau d’âne peut se refaire une garde-robe. Les costumes, volontairement connotés, rappellent de toute évidence le monde magique du conte pour enfants, jouant la carte du gag et du clin d’œil attendrissant.
Magnifique distribution pour la lecture partielle d’une œuvre qui ne garde que la dimension comique du propos. Philippe Awat assure une direction d’acteurs d’une précision déconcertante qui dénude un roi époustouflant de justesse. Eddie Chignara (Le Roi), excelle dans une interprétation excessive d’un roi en proie à sa démesure. Nu ou habillé, il est d’une touchante sincérité et d’une générosité sans concessions. Pascale Oudot (La Princesse), candide et amoureuse, s’amuse à déjouer les codes trop convenus d’une écriture résolument contemporaine. Elle est la princesse au petit pois, aux robes de lumière et à la spontanéité déconcertante. Françis Ressort, aérien et subtil en jeune porcher aux formes apolliniennes, mène la danse avec toujours plus de plaisir, tout comme l’ensemble des comédiens entre lesquels le mot complicité semble faire autorité.
Une remarquable prestation, pour laquelle il ne faut surtout pas s’attendre à retrouver le propos politique de l’auteur, les comédiens s’amusent et le public avec.
Le Roi Nu
De : Evguéni Schwartz
Mise en scène : Philippe Awat
Avec : Anne Buffet, Eddie Chiragna, Mikaël Chirinian, François Frapier, Dominique Langlais, Pascale Oudot, Bruno Paviot, Magali Pouget, Françis Ressort
Scénographie : Valérie Jung, Frédérique Pierre, Nicolas Faucheux, Philippe Awat
Lumières : Nicolas Faucheux
Musique : Victor Belin, Antoine Eole
Son : Emmanuel Sauldubois
Costumes : Dominique Rocher
Maquillages et perruques : Nathy Polak
Animation graphique : Fanny Paliard
Chorégraphie : Véronique Ros de la Grange
Du 20 janvier au 14 février 2010
Théâtre de la Tempête
Cartoucherie, Route du Champ de Manœuvre, 75 012 Paris
www.la-tempete.fr
Read More →
Critique • « Thé à la menthe ou t’es citron ? » de Patrick Haudecœur au Théâtre Fontaine
// Jan 21st, 2010
Critique de Bettina Jacquemin –
Acteurs calamiteux pour succession d’imprévus
Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard : un gentleman cambrioleur s’introduit chez une aristocrate… Tout y est : le cocu, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus.
Nous sommes à quelques jours de la première, rien n’est prêt. Chez les comédiens, l’ambiance est électrique, l’actrice principale est au bord de la crise de nerf à cause… du jeune premier, le fils du producteur, imposé – le bouquet ! Maladroit, timide, naïf et gaffeur il fait ses premiers pas sur les planches.
Le soir de la première arrive… Les imprévus s’enchaînent dans une folie vertigineuse. Les acteurs tentent désespérément de récupérer catastrophes sur catastrophes. C’est une apothéose de quiproquos et de gags inattendus…
En deux temps…
Patrick Haudecœur reprend Thé à la menthe ou t’es citron. Avis aux amateurs : on est ici dans le pur divertissement ! Des pseudo-comédiens tentent de répéter tant bien que mal un spectacle… Une pièce dans la pièce. L’idée est originale.
Le temps des répétitions
Le début est poussif et manque de fluidité. Si les “codes” du Boulevard sont respectés (gags un peu lourds que l’on voit arriver de très loin), on échappe pas aux répliques qui tombent à l’eau.
On se laisse finalement prendre par la sincérité de l’histoire. Le spectateur est au cœur des répétitions ; il devient petit à petit complice du jeu.
On apprécie le jeu des comédiens Isabelle Spade et Jean-Pierre Lazzerini. L’un en metteur en scène au féminin, patient à souhait et l’autre en technicien bougon mais imperturbable.
La pièce dans la pièce
Une voix nous annonce que l’on peut prendre des photos avec ou sans appareil… le ton est donné. Le rythme s’accélère. Le spectateur assiste aux imprévus rencontrés par les comédiens. La mauvaise musique démarre au mauvais moment et la comédienne perd sa perruque. Un condensé d’imprévus !
L’occasion, enfin de rire à gorge déployée !
Thé à la menthe ou t’es citron
– Molière 2011 de la pièce comique –
De : Patrick Haudecoeur et Danielle Navarro-Haudecoeur
Mise en scène : Patrick Haudecoeur
Avec : Jean-Luc Porraz , Nathalie Cerda, Isabelle Spade, Patrick Haudecoeur, Jean-Pierre Lazzerini / Bob Martet, Sandra Biadalla, Edouard Pretet
A partir du 12 janvier 2010
Reprise du 6 août 2010 au 2 janvier 2011
Reprise du 16 septembre au 31 décembre 2011
Théâtre Fontaine
10 rue Fontaine, 75 009 Paris
www.theatrefontaine.com
Read More →
« Deux Voix » de Pasolini et Herkströter aux Amandiers
// Jan 21st, 2010
Critique de Camille Hazard –
Un comédien, seul en scène, tenant en haleine tout un public pendant 1h45, ce n’est malheureusement pas souvent que l’on assiste à cela au théâtre.
Et pourtant, Jeoren Willems nous tient, nous déconcerte, nous questionne, à travers une suite de monologues adaptés de plusieurs textes de P.P.Pasolini ainsi que par diverses opinions morales et sociales de l’ancien président du conseil d’administration de Shell international : Cor Herkströter.
Poète, dramaturge, cinéaste, philosophe…Pasolini est mort en 1975, assassiné par des fascistes sur la plage d’Ostie en Italie.
Ses idées ont toujours dérangé, déstabilisé les gens de pouvoir, d’argent, de religion ; l’infernale Trinité galopante. Toute sa vie Pasolini s’est fait la voix du peuple et il est rassurant maintenant de voir ses idées mises en chair sur une scène. Ces textes, adaptés par Tom Blokdijk et Paul Slangen, proviennent de recueils méconnus du grand public dans lesquels l’auteur s’interroge sur ce qu’est la politique, la culture, la société… «Écrits corsaires », « Lettres Luthériennes », « L’expérience hérétique »…
Pasolini s’interroge : « Pourquoi l’homme a t il autant besoin de consommer, d’amasser coûte que coûte, de posséder tout et à n’importe quel prix ? » Est-ce l’angoisse de la mort ? L’instinct de survie poussé au paroxysme ? Pasolini a, durant toute sa vie, critiqué les corrompus du pouvoir en place, le peu de Foi et de sacré chez les hommes d’églises, la Mafia et son mépris pour les citoyens…Mais s’il a pointé du doigt les « puissants » de ce monde, il a également apporté des réponses. Des réponses politiques, mais aussi sociales, culturelles… avec des idées tout à fait réalisables. Ce ne sont donc pas des écritures utopiques ! Sa lutte constante a fini par s’écouler dans chaque pore de sa peau jusqu’à ce qu’il en soit mort.
– Le monstrueux, l’homme de Foi et l’intellectuel –
Jeoren Willems incarne plusieurs personnages su scène : un haut fonctionnaire satisfait, grossier et arrivé au terme de ses ambitions professionnelles, un jeune cadre émoustillé par son avenir prometteur, un intellectuel travesti qui rêve de sainteté, un homme d’église sans Foi, et enfin un homme, la voix de Pasolini, qui ouvre le spectacle et qui le clôt par un geste puissant et porteur de sens. Les confessions de ces personnages s’enchaînent, le public se retrouve seul face à de troublantes questions : quel lien y a t il entre la dérision des hommes puissants et le poing levé d’un ouvrier ? Qu’est ce qui se cache derrière la volonté de sainteté absolue ? Qu’est ce qui se cache, tapi dans l’ombre, derrière ce qu’on appelle conventionnellement « le Bien » ?
– Réquisitoire et plaidoyer : Multinationales levez vous ! –
L’idée de ce spectacle est percutante, pleine de justesse, car après avoir entendu la voix de Pasolini, à travers les différents personnages, nous écoutons le plaidoyer d’un directeur d’entreprise internationale qui parvient à nous convaincre comme le font tous les autres personnages. Le public peu éclairé sur l’auteur, aura la tête chamboulée et remplie d’interrogations. Mais le public dit « de gauche », engagé lui-même devra lui aussi se remettre en question ! Aucune démagogie dans le spectacle !Dans leur discours, toutes les voix ont un sens, la solution de la vie réside dans l’équilibre parfait, entre les valeurs humaines, l’égalité des peuples, le sacré qui nous habite, et le capitalisme.
Le spectacle commence
Fin de soirée, une table jonchée de bouteille d’alcool, de restes de desserts, de chaussures, de bas, un éclairage cerclé comme au cabaret ; la mise en scène nous ramène à l’ambiance des « Damnés » de Visconti : la fête à outrance, l’impression d’extrême liberté sexuelle, cache en fait quelque chose de très noir qui se prépare sous nos yeux.
L’acteur est presque toujours assis autour de la table, comme si les personnages en avaient besoin pour tenir face à nous. La table, l’alcool : seuls piliers dans un monde qui s’effondre. J.Willems ne joue pas, il vit sur scène. On ressent chez lui un besoin vital d’être là, de nous parler. Sa conviction sur scène n’a rien à envier à celle de Pasolini ! Son jeu n’ai jamais vulgaire, parfois monstrueux, ailleurs drôle ou même pitoyable, mais en aucun cas, il ne tombe dans la facilité. L’adaptation du texte, la mise en scène, l’éclairage et la musique accompagnent le jeu de l’acteur qui se suffit à lui-même. Rien n’est jamais appuyé. Seul compte le texte, ainsi que le corps qui lui donne vie car les textes de P.P Pasolini sont bien plus forts que n’importe quel discours politique de droite comme de gauche.
Deux Voix
De : Pier Paolo Pasolini et Cor Herkströter
Avec : Jeoren Willems
Mise en scène : Joan Simons
Adaptation : Tom Blokdijk et Paul Slangen
Dramaturgie : Paul Slangen
Traduction : Monique Nagielkopf
Scénographie : Joan Simons et Piet Hein Eek
Lumière : Joan Simons
Son et Musique : Flor Boddendjik
Costumes : Ateliers NTGENT
Du 6 janvier au 10 février 2010
Théâtre Nanterre Amandiers
7 avenue Pablo Picasso, 92022 Nanterre
www.nanterre-amandiers.com
Read More →

Critique de F. Fauvernier –
Traîtrise, héritage, magot, luxure, folie et au bout : La mort …
Fables morales sur la fausseté des sentiments, le Roi Lear et Richard III, ces deux chefs-d’œuvre de Shakespeare sont montés en diptyque par Jean-Claude Fall, désireux de mettre en valeur la tragique figure du père destructeur par son omni-présence, Lear, ou son absence, Richard.
Jean-Claude Fall signe en même temps la fin de son « règne » sur le CDN (centre dramatique national) du Languedoc-Roussillon.
« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute «
© Marc Ginot
… « Jusqu’au moment où le flatté lui cède son bien « , pourrait-on logiquement penser. Oui mais, avec Monsieur William, on peut être sûr que « celui qui l’écoute » ne va plus vivre très longtemps, le flatteur non plus d’ailleurs finalement.
Frères, pères, sœurs, filles. Mari, amant. Ici tout le monde meurt assassiné. Cette famille, où le parricide, le fratricide se vivent au quotidien, n’a rien à envier aux plus beaux personnages de la tragédie grecque, Œdipe en tête.
Un conte initiatique d’un côté, de l’autre une pièce politique violente et contemporaine. Le même décor avec les mêmes lumières et la même troupe.
Manipulation, aveuglement, passion, cynisme… certes, mais aussi de l’amour, beaucoup d’amour !
« Lorsque nous venons au monde, nous pleurons d’être jetés sur cette grande scène de fous. »
Le Roi Lear
Deux pères sont manipulés et trahis, l’un par ses filles, l’autre par son fils Edmond. Lear et Gloucester.
Sur un plateau incliné, au début recouvert d’une toile de couleurs pastel avant de laisser place à du bois brut, les protagonistes marchent, courent, sautent, rampent, s’aiment, se chassent.
« Quel est ce monde où les fous guident les aveugles », interroge Gloucester, martyrisé, dans une chemise rougie de son sang.
C’est celui d’un souverain devenu fou.
Jean-Claude Fall, non seulement traducteur, créateur lumière et metteur en scène, est éblouissant d’énergie passionnée dans le rôle complexe et torturé de Lear.
Souverain devenu fou, il nous fait assister à un tableau tout à la fois grandiose et poignant : sa rencontre avec Tom (David Ayala, attachant Tom-Edgar rebondi), au cœur d’une véritable tempête chargée de coups de tonnerre et gorgée d’une pluie véritable, cascadant sur le plateau. C’est magique !
Magie qui plus tard, quand, Tom-Edgar et son père, le comte de Gloucester, se retrouvent, soulignée par la musique de Dimitri Chostakovitch, va peu à peu se transformer en émotion.
Émotion qui nous emmène jusqu’au dénouement final : la mort en duel de l’infâme bâtard Edmond (Luc Sabot à la fois charmeur et venimeux), la fin tragique de la douce Cordelia (Christel Touret à la fois Cordelia sensible et tendrement clownesque), aimante Cordelia, dans les bras de Lear, agonisant, fou de douleur.
Le Roi Lear / Richard III
De : William Shakespeare
Mise en scène : Jean-Claude Fall
Scénographie : Gérard Didier
Dramaturgie : Gérard Lieber
Costumes : Marie Delphin, Gérard Didier
Lumières : Martine André, Jean-Claude Fall
Musique : Dimitri Chostakovitch (arrangement vocal dans Richard III : Luc Sabot)
Son : Serge Monségu
Vidéo : Laurent Rojol
Assistants à la mise en scène : Marc Baylet, Stéphane Laudier
Avec : David Ayala (Richard III), Jean-Claude Fall (Lear) et Marc Baylet, Jean-Claude Bonnifait, Julien Guill, Grégory Nardella, Patrick Oton, Alex Selmane et Roxane Borgna, Isabelle Fürst, Fanny Rudelle, Luc Sabot, Christel Touret de la troupe du Théâtre des Treize Vents
Du 4 au 31 janvier 2010
Théâtre des Quartiers d’Ivry
1 rue Simon Dereure, 94200 Ivry-sur-Seine
www.theatre-quartiers-ivry.com
Read More →
« Casimir et Caroline » d’Ödön Von Horvath au Théâtre de la Ville
// Jan 21st, 2010
Critique de Monique Lancri –
Au Théâtre de la Ville, Casimir et Caroline ne se retrouvent que pour se perdre à nouveau !
Ödön von Horvath (1901-1938) écrit « Casimir et Caroline » en 1931. L’Allemagne, qui compte alors six millions de chômeurs, est en pleine crise. Aussi le peuple se complaît-il dans des fêtes qui lui font oublier ses soucis. C’est dans ce contexte que s’ouvre la pièce. Nous sommes à Munich, lors de la fête d’Octobre. Caroline y a traîné son fiancé Casimir. Au chômage depuis la veille, celui-ci n’a guère le coeur de s’amuser. A peine arrivés, les amoureux se chamaillent. Caroline, comme la foule autour d’elle, est fascinée par le zeppelin qui passe au-dessus de leurs têtes, tandis que Casimir, lui, n’y voit « qu’esbrouffe » ! Malentendus, mauvaise foi : les jeunes gens ne vont se fuir et se chercher que pour finir par se séparer.
© Jean-Louis Fernandez
« Je t’aime, moi non plus »
Sur fond de drame social, il n’est donc question que d’amour dans la pièce de Horvath. La mise en scène de Demarcy-Mota semble avoir privilégié la sincérité chez Casimir plutôt que chez Caroline. Casimir (Thomas Durand), fragile, inquiet, pessimiste, passe son temps à guetter Caroline (Elodie Bouchez) ; s’il quitte la fête au bras d’Erna (Sarah Kabasnikoff), c’est plus par dépit que par passion (il n’accompagne d’ailleurs celle-ci qu’après s’être assuré qu’elle n’est pas tuberculeuse!). Il envisage même de se pendre quand Caroline annonce qu’elle le quitte vraiment. Elodie Bouchez campe une Caroline fofolle, un peu dure, un peu naïve aussi, et un brin mélancolique. Une Caroline qui ne vit que dans l’ici et le maintenant : l’ici d’une glace à déguster, le maintenant d’un tour en Grand Huit puis d’un autre dans la décapotable d’un nouveau et riche prétendant…Tourne manège, comme dans « La Ronde » (1900) de Schnitzler: d’abord dans les bras de Casimir, puis dans ceux de Rauch (Alain Libolt). Ensuite ? Casimir de nouveau ; et enfin Schürzinger : pourquoi pas ?
« Emportés par la foule … »
© Jean-Louis Fernandez
Autour des deux protagonistes, dans un décor (un peu trop) expressionniste, tournoient des personnages hauts en couleurs mais noyés dans la foule ; parti-pris de mise en scène : le collectif prend le pas sur l’intime. Car Demarcy-Mota et François Régnault, qui, pour la circonstance, a retraduit la pièce, ont choisi d’insérer entre les scènes « des dialogues à multiples voix, adaptés d’autres oeuvres de Horvath … » ; ce qui a pour effet, et c’est dommage, de distraire l’attention : le spectateur ne sait plus très bien, par exemple, où, dans un groupe de fêtards, se trouve Franz (Gérald Maillet ), le « mauvais garçon », ami de Casimir ; quant à Erna, la compagne de ce dernier, elle se confond trop souvent avec les autres filles. …En revanche, le regard reste accroché à Schûrzinger, malgré la « médiocrité » du personnage, tant la performance de l’acteur (Hugues Quester) est remarquable.
La scène dite du « manège de chevaux » constitue l’un des moments esthétiquement les plus puissants. Très surréaliste, un gigantesque cheval mécanique se détache sur un décor entièrement rouge; non le rouge de la passion, mais celui de l’embrasement futur (prémonition de l’incendie du Reichtag?), avant le dénouement de la pièce dans une quasi obscurité aux tons de cendres, où l’on comprend, comme le dit Demarcy-Mota, « qu’un homme peut devenir un monstre », pire que les monstres exhibés à la foire ! L’aéronef se fait encore entendre, effrayant cette fois. Plus de « Bravos » pour le saluer, comme au début. Mais le silence. Le néant. Ce qui donne force et pertinence au dernier mot prononcé par Casimir : « Rien ».
Casimir et Caroline
De : Ödön Von Horvath
Nouvelle traduction : François Regnault
Mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota
Assistant à la mise en scène : Christophe Lemaire
Avec : Thomas Durand, Elodie Bouchez, Hugues Quester, Alain Libolt, Charles-Roger Bour, Gérald Maillet, Sarah Karbasnikoff
Scénographie et lumière : Yves Collet
Environnement sonore : Jefferson Lembeye
Du 19 au 24 janvier 2010
Théâtre de la Ville
2 place du Châtelet, 75 004 Paris
www.theatredelaville-paris.com
Voir aussi :
La critique de Bruno Deslot à propos du livre Casimir et Caroline
Read More →
« Deux tickets pour le paradis » de Jean-Paul Alègre
// Jan 21st, 2010
Lecture de Plume –
Un certain Jeff arrive au paradis mais personne ne semble attendre sa venue. L’énigme l’est également pour Dieu, car si les fichiers célestes laissent à désirer depuis que Saint Odilon se charge des renseignements généraux, la mémoire du nouveau-mort est elle-même aussi vide que la valise qui est montée tout droit avec lui. Cette amnésie va paradoxalement se transformer en prétexte existentiel. Les questions fuseront de toute part, pour Jeff, comme pour Dieu, Marie, Saint Pierre et Angélique, la fille de Dieu, inconnue de nos catéchismes. Chacun doit rendre des comptes sur des postures bibliques, mais aussi, actuelles ou créées de toutes pièces. Pièce est le maître mot. Lorsque Jeff aura son premier souvenir terrestre, et que Dieu lui accordera sa fille, l’humanité se trouvera dotée d’un couple supplantant celui d’Adam et Ève, pour se donner une nouvelle chance de recomposer le monde, à partir de l’univers théâtral. Dans la mathématique divine, la vie et le théâtre ne font plus qu’un. Et, au final, pour notre plus grand plaisir, l’on ne sait plus, ce qui de l’existence ou du théâtre, est mis en abîme.
Le talent de Jean-Paul Alègre n’est plus à démontrer. Ce texte, traversé d’humour d’un bout à l’autre, est un bonheur. Il interroge cependant, sur divers points de société, sans jamais s’appesantir, avec l’élégance de ceux qui résistent, sans s’apitoyer sur leur sort, au théâtre complexe de la vie.
De l’alibi des patrons
Les patrons se sont d’abord les Saints. Et le patron des Patrons est Dieu, qui ne cesse de s’exclamer « Nom de moi de nom de moi ! ». Ils vivent au paradis, dans un « ailleurs », où le temps se compte en parcelle d’espace (les gouttelettes des nuages remplacent poétiquement nos périodes temporelles terrestres) et la musique se module en atmosphères de nostalgie (le blues) ou de gloire (par ordre de tumulte hiérarchique). Jésus lui-même est encore ailleurs, puisqu’il est introuvable. Il plait à Marie d’imaginer son fils revenu sur terre en infirmier qui s’occuperait avec d’infinies précautions de changer « la perfusion d’un enfant malade dont le crâne chauve luit comme un signal dans la pénombre ». Ces « ailleurs » grandissent donc le champ des possibles ontologiques. De même, quelques répliques de Jeff, telles que « Vous autres, les dieux, vous êtes des boutefeux de la violence… », entraînent certaines problématiques critiques, comme les religions menant au fanatisme, mais sont aussi des passerelles métaphoriques. Et l’auteur passe donc de cet « alibi », qui est d’ « être ailleurs » dans sa définition, à la question des potentiels alibis des gouvernants, autres « patrons » bien terrestres, qui au vu des massacres « ne s’y sont pas toujours opposés avec la plus grande vigueur. »
Le temps des cerises
Saint Pierre se lance pour Angélique dans un succulent monologue, « la tirade des cerises ». Il nous conte son cheminement sur terre auprès du frère de celle-ci, Jésus, lorsqu’ils traversent tous deux le Pays basque. L’une des conclusions en sera qu’il « n’est pas si simple que cela d’être homme ». En effet, refusant de se baisser pour ramasser un vieil objet rouillé (un fer à cheval pourtant !) sous une chaleur accablante, il loupe le temps des cerises ! Jésus « s’abaisse » à le faire et en tire un troc pour étancher la soif, des cerises, que, chemin faisant, il fait semblant d’égarer. Pierre, à la traine, les « carotte » une par une, sans réaliser qu’il fait cent fois le geste de se baisser qui lui avait été demandé une unique fois. Jésus, en merle moqueur, lui montre la différence entre le geste solidaire et l’individualisme. Être homme commence par faire en soi une petite révolution.
La clef de Saint Pierre
C’est ce bon (avec un caractère bien trempé, comme tous les personnages brossés ici par l’auteur) Saint Pierre, gardien du trousseau, qui, sans le savoir, va nous donner la clef de l’énigme de la présence de Jeff au paradis, avec cette question « Et la valise vide ? ». De cette vacuité va poindre une déduction très logique, à laquelle pourtant personne ne songe au départ. Et pour ne pas la dévoiler, nous pourrions simplement dire que Jeff et sa valise, dans ce cas précis, forment une synecdoque bien complice.
Une histoire de tickets
Jeff et Angélique « ont le ticket » l’un pour l’autre. Dieu et Marie également. Et Dieu va même jusqu’à concrétiser son amour pour Marie, et pour l’humanité, en offrant à sa bien-aimée deux véritables tickets pour aller au spectacle du nouveau monde, prochainement interprété par le jeune couple. Certes, la place est acquise et ils sont bien situés, au septième rang, bien sûr. C’est lorsqu’il n’est pas question de ticket, quand il n’y a pas de laisser passer tangible, quand on vous le refuse, ou qu’on vous l’arrache, que la vie s’emporte et bascule dans l’innommable. Et l’auteur de citer du Grumberg et de décrire le sort fatal réservé à ceux qui étaient montés gracieusement dans les camions, sans savoir qu’on les dirigeait encore plus vite que les autres vers les camps de la mort. Le ticket, ou plutôt l’absence de ticket (… de papiers, d’identité…), prend une dimension tragique, devient métaphore du génocide. Sa présence est une image d’amour et devient métaphore de création. Et le titre « Deux tickets pour le paradis » prolonge le constant parallèle fait par l’auteur entre le théâtre et la vie, comme un espoir à s’entretenir mutuellement, afin que ne vacille jamais la petite flamme de l’humanité.
Un flux de thématiques parcourt la pièce sans qu’on s’ennuie une « gouttelette », grâce à l’expression poétique, riche, dynamique, enlevée, et, à une duplicité du sens, criblée d’humour de Jean-Paul Alègre. Une pièce, revisitant les cosmogonies, qu’on a hâte de voir sur le plateau…Quel plateau ? Ciel, Terre ou théâtre, qu’importe ! « Où que nous soyons, quoi que nous fassions, l’important c’est ce que nous sommes. »
Deux Tickets pour le Paradis
De Jean-Paul Alègre
L’avant-scène théâtre
75 rue des Saints-Pères, 75006 Paris
www.avant-scene-theatre.com
Read More →
Rencontre avec l’auteur et metteur en scène Pierre Notte
// Jan 19th, 2010
une rencontre de Bruno Deslot –
Un succès consacré ! Pierre Notte a ouvert la résidence que lui consacre Les Déchargeurs tout au long de sa saison 2009/10 par la mise en scène de sa pièce Les Couteaux dans le dos, reprise au Théâtre La Bruyère à partir du 28 janvier 2010. Le spectacle sera en tournée en France et à l’étranger dès octobre 2010. Au cours de cette tournée, le spectacle participera en novembre prochain au Festival d’automne de Pazardjik (Bulgarie) organisé par le Théâtre dramatique national Constantin Velitchkov dont le directeur Vladlen Alexandrov présentera parallèlement sa version bulgare de la pièce. Avant de reprendre en octobre dernier au Théâtre du Rond-Point son cabaret J’existe (foutez-moi la paix) créé aux Déchargeurs en 2006, le mois d’octobre a vu paraître le premier album de Pierre Notte J’existe (et je danse) interprété avec Marie Notte et le PMB trio. En tournée depuis décembre 2009, le cabaret J’existe (foutez-moi la paix) sera représenté au mois de mai prochain au Madina Theater de Beyrouth (Liban), puis à Dubaï (E.A.U.) et à Abu Dhabi (E.A.U.) en collaboration avec l’Alliance française de Dubaï. La résidence aux Déchargeurs s’est poursuivie avec la création du Cabaret des familles en novembre dernier, en compagnie de Marie Notte et du PMB trio, puis se prolongera avec, pour la première fois, un spectacle pour tous écrit par Pierre Notte, mis en scène par Sylvain Maurice : Bidules, trucs. L’invitation faite à Pierre Notte se clôturera par la présentation de la version bulgare (sous-titrée en français) de sa pièce Moi aussi, je suis Catherine Deneuve dans une mise en scène de Vladimir Petkov.
À l’occasion des représentations de la pièce « Les Couteaux Dans le Dos » au Théâtre La Bruyère, Bruno Deslot a rencontré l’auteur et metteur en scène Pierre Notte.
Des couteaux dans le dos assassinent vos peurs pour libérer vos désirs d’être ?
Pierre Notte : Cette pièce est un vrai parcours initiatique. C’est l’histoire d’une jeune fille qui passe par des états très différents, c’est mon Peer Gynt à moi, avec amour, insolence et respect à l’égard des grands maîtres du théâtre scandinave. Le parcours initiatique de cette pièce consiste, pour Marie, à en passer par l’espace domestique, trop petit pour elle, qu’elle va exploser, par les monstres, le trottoir, les autoroutes, par le refus de tout et par l’acceptation de tout, jusqu’à même s’interroger sur la mort. Est-ce qu’il ne vaut pas mieux en finir ? Elle passe par toutes les interrogations possibles et donc par toutes les peurs, pour accepter que le salut, la survie, le repos passe probablement par l’autre, c’est-à-dire la place accordée à l’autre. Tout ce qui motive cette jeune fille, c’est la quête de sa propre identité.
Votre pièce est construite comme un conte. Elle en respecte le schéma narratif. Quel est la quête du personnage principal ?
PN : La quête de ce personnage serait la paix avec soi-même. Le personnage principal, Marie, part pour fuir, sans comprendre ce qu’elle fuit, mais est bien vite confrontée à un problème, c’est-à-dire elle. La question, c’est comment faire pour s’en sortir ? Elle dit « oui » à tout, elle dit « non » à tout et finit par faire la synthèse. Ceci est un jeu pour nous dans la manière de raconter ce parcours initiatique avec tous les personnages qu’elle rencontre sur son parcours. Mais il faut que Marie en passe par une sorte de violence pour en arriver à une sorte de paix avec elle-même et cette paix, peut-être, c’est l’autre. La mort est envisagée dans une dimension très symbolique et amusée puisqu’il s’agit d’en faire l’expérience et d’en revenir. Après avoir effectuée de nombreuses rencontres, Marie en arrive à la morale de cette histoire, qui est peut-être, vivre quelque chose plutôt que rien. C’est une pièce qui est constituée de citations, de beaucoup de citations, de Rilke par exemple dan son ouvrage Les lettres à un jeune poète : « L’amour est un travail pour lequel tout autre travail n’est que préparation ».
Marie, qui cherche à se cacher du monde, est elle encore dans une forme de réalité, même lorsqu’elle se coupe ?
PN : Dans ce parcours initiatique, elle dit « non » à tout et va tout refuser, l’école, la famille, le cadre social, même le rêve qu’elle avait initié d’être gardienne de péage, qui la coupait du monde ; c’était mon rêve lorsque j’étais petit, je voulais être gardien de péage. C’était mon seul rêve car je voyais les gens isolés dans leur bloc de verre, avec un petit écran et tout à portée de mains. Ils étaient au bout du monde, loin des villes, des champs. Il y avait une sorte d’hypnose dans l’isolement qui me convenait parfaitement. Dans cette configuration, c’est le refus du monde de la part de Marie lorsqu’elle dit « non » à tout. Puis après, elle va vers l’autre et là tout le monde arrive dans son monde et elle dit « oui » à tout, mais alors sans plus de discernement, non plus. Enfin, elle fait le bilan. Après, elle se coupe, en effet, et c’est sa modalité d’être au monde et de ne pas y être bien.
Vous avez écrit Des couteaux dans le dos sous l’influence de Bergman, Clouzot, Rilke, Genet, Cocteau, Pasolini, Prévert etc… On a le sentiment que ces auteurs font plus que vous influencer, mais vous accompagnent, vous construisent.
PN : Non seulement, ils accompagnent et construisent la pièce mais en plus ils contribuent à son écriture. Lorsque je dis avoir écrit la pièce sous l’influence de ces auteurs, c’est par immodestie car il y a beaucoup de citations. Il y a une scène entière Des corbeaux de Clouzot qui est citée. Il y a des phrases de Rilke, d’Ibsen, de Godard qui sont citées, parce que c’était aussi important qu’il y ait cette circulation dans les influences, dans les choses qui nous tiennent à cœur.
Des couteaux dans le dos est aussi un spectacle musical. Comment avez-vous conçu la mise en scène ?
PN : La mise en scène est très musicale et très attachée à la musique du texte. Elle n’est pas du tout conçue dans un espace réaliste puisqu’on a affaire à cinq jeunes filles qui ont à interpréter une trentaine de personnages dans des lieux très différents, représentés par une chaise et une table. L’ensemble repose sur l’énergie des cinq actrices qui se trouvent dans un mouvement, un ballet permanent. Il y a un jeu de lumières très important avec 70 installations pour une pièce qui dure 1h15, car tout se joue dans la lumière, dans le mouvement et l’énergie des jeunes filles. C’est un véritable tourbillon incessant avec des figures très expressionnistes, très marquées par des mouvements presque mécaniques. En revanche, la figure de la jeune fille est extrêmement naturaliste, elle est perdue dans un monde imaginaire. L’ensemble est tellement dense et intense et va tellement vite, que nous essayons d’être dans des moments d’aération. Pour cette reprise au Théâtre de la Bruyère, nous avons tenu compte de réserves ou critiques afin de nous situer dans un rythme au plus proche de ce que nous voulions transmettre. Les 1h25 de spectacle à l’origine, se sont réduites à 1h15, car l’ensemble est tellement dense, intense qu’il fallait procéder à la réécriture de trois scènes afin que le spectateur apprécie la pièce d’un bout à l’autre en étant toujours en état d’alerte. C’est un spectacle qui demande une attention très particulière, car la langue n’est pas simple, le mouvement incessant et l’intensité, permanente.
Auteur invité aux Déchargeurs, vous voici auteur associé et conseillé au Théâtre du Rond Point. Quelles sont vos fonctions dans ce théâtre ?
PN : Je travaille aux côtés de Jean-Michel Ribes et toutes sortes de gens du Théâtre, qui sont extrêmement ouverts, disponibles, généreux, qui travaillent dans des conditions où la première exigence est que le travail ne doit pas être un lieu de souffrance. Il y a ici, une liberté de ton, d’action, une légèreté, une efficacité d’action qui sont incessantes. Nous sommes en perpétuel mouvement. Nous avons, avec Jean-Michel Ribes, le projet de fonder une école de théâtre, celle du Rond Point et de revoir même, à certains endroits, l’accueil du public. Je participe aussi à la programmation avec toute l’équipe de direction, puisque c’est un travail partagé qu’organise Jean-Michel Ribes. J’écris aussi, toutes les brochures qui concernent les spectacles de la saison prochaine, dans laquelle je jouerai une pièce que j’ai écrite et qui s’intitule Et l’enfant sur le loup que Patrick Kerbrat mettra en scène. Mes partenaires de jeu, seront Judith Magre et Jean-Jacques Moreau. C’est une pièce que j’ai écrit pour Judith Magre et qui commence par « J’en ai marre de ma gueule et je fais déjà vieille pute. » Je jouerai le rôle du loup dans cette pièce. Je suis vraiment très heureux et enthousiasmé par tous ces projets.
Voir l’article
Des couteaux dans le dos
De et mis en scène par Pierre Notte
À partir du 28 janvier 2010
Théâtre de la Bruyère
5, rue de la Bruyère
75 009 Paris
www.theatrelabruyere.com
Read More →
Festival Le Standard Idéal à la MC93, 7e édition // 29.01 – 19.02.11
// Jan 17th, 2010
Une programmation ambitieuse et foisonnante
Après l’excellent cycle Lev Dodine donné en 2009, dans le cadre du Standard Idéal, l’édition 2010 de ce festival s’annonce particulièrement diversifiée et foisonnante. Rendez-vous international, qui regroupe des artistes moins établis que ceux des années précédentes, la programmation explore le monde avec des propositions très implantées dans notre époque. Comme le précise Patrick Sommier, « c’est vraiment le foisonnement du monde qui s’exprime à travers cette nouvelle édition ».
Des artistes audacieux qui définissent le théâtre comme lieu de passion et de découverte.
Une programmation idéale pour un Standard 2010 expérimental.
LA FLÛTE ENCHANTÉE (voir l’article)
D’après Mozart
par l’Orchestre di Piazza Vittorio
Direction artistique : Mario Tronco
Les 29 et 30 janvier à 21h00 et le 31 janvier à 15h30
Mario Tronco, fondateur de l’Orchestra di Piazza Vittorio, rassemblant à Rome des musiciens cosmopolites, propose une Flûte enchantée festive et populaire. De Cuba au Mali, de la Hongrie à l’Equateur, de l’Argentine à la Tunisie etc… La Flûte enchante des musiciens de tous horizons, célébrant ainsi l’universalité si nuancée de la musique et la force fédératrice de l’art. Ainsi, les personnages de La Flûte se retrouvent dans la peau des musiciens de l’Orchestra di Piazza Vittorio pour voyager à travers les pays de ces artistes. Evitant le piège de la juxtaposition ou de folklore, l’Orchestra réussit à trouver une unité quasi miraculeuse.
BLACKFACE
Spectacle en Néerlandais surtitré
D’après John Updike
Mise en scène de Vincent Van Warmerdam et Michel Sluysmans
Les 4 et 5 février à 20h30, le 6 février à 19h00 et le 7 février à 17h30
Fondée dans les années 70 par une bande peu disciplinée de jeunes comédiens, musiciens et plasticiens hollandais, la compagnie Grime revendique une liberté sans conditions et une impertinence avérée dans ses propositions. Portant un regard critique sur l’establishment du théâtre et sur la société convenue, la compagnie ne déroge pas à ses engagements pour Blackface. Orkater propose une composition insolente et drôle sur la trame de Brasil, roman de l’écrivain américain John Updike. Auteurs et metteurs en scène de cette production reprennent le fil de l’intrigue inspiré de la légende de Tristan et Iseult, pour la détourner à leur manière. La fable est déplacée dans l’Amérique ségrégationniste pour mieux en manipuler les clichés. La tradition du Blackface, théâtre populaire au XIXe siècle où les Blancs se barbouillaient le visage pour se moquer des Noirs, est habilement détournée au profit d’un spectacle incisif et musical.
WOYZECK
Spectacle en allemand surtitré
De Georg Büchner
Mise en scène de David Bösch
Le 6 février à 21h00 et le 7 février à 15h30
Après avoir présenté une remarquable Nuit des Rois en octobre dernier à la MC93, David Bösch revient avec Woyzeck, une proposition délicieusement grotesque et décadente. Le chef-d’œuvre inachevé de Georg Büchner (1813-1837) à l’aspect fragmentaire, permet toutes les audaces et lectures, que David Bösch exploite de manière atypique, mêlant, dans une mise en scène radicale et moderne, la puissance des images, une grande intensité émotionnelle et une tension dramatique exacerbée, l’ensemble évoluant au rythme d’une bande son, s’inspirant de la culture pop.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CIVILISATION À VENIR
D’après « Une Maison de Poupée »
D’Henrik Ibsen
Adaptation, mise en scène et scénographie de Daniel Veronese
Le 11 février à 20h30
et
TOUS LES GRANDS GOUVERNEMENTS ONT ÉVITÉ LE THÉÂTRE INTIME
D’après « Hedda Gabler »
D’Henrik Ibsen
Adaptation, mise en scène et scénographie de Daniel Veronese
Le 13 février à 20h30
Intégrales le 13 février à 20h30 et le 14 février à 15h30
Spectacles en espagnol surtitré
Après ses adaptations d’Oncle Vania et Des Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, l’auteur et metteur en scène, Daniel Veronese explore l’univers d’Henrik Ibsen en proposant des versions contemporaines d’Une Maison de poupée et d’Hedda Gabler. Ne cherchant pas à remanier des classiques par principe ou par jeu, Daniel Veronese mène un travail qui consiste à convertir des pièces classiques en œuvres de théâtre. Pour le metteur en scène, Nora, d’Une Maison de poupée, éclaire la question de la condition féminine alors qu’Hedda, de Hedda Gabler, est au contraire une femme dont le fonctionnement est plus incompréhensible, un personnage à la fois obscur et infantile. Ces deux femmes luttent pour leur liberté, l’une en direction de la vie, l’autre de la mort.
LA TOISON D’OR (voir l’article)
L’invité, Les Argonautes, Médée
Texte de Franz Grillparzer
Mise en scène de Karin Beier
Les 18 et 19 février à 20h00
Spectacle en allemand surtitré
Accompagnée de trois comédiens, Maria Schrader excelle dans le rôle titre de cette création qui a pour sujet l’aliénation des hommes et des femmes. Dès la première scène, Médée décide de ce qu’elle veut faire et fera par la suite. Le texte de Franz Grillparzer (1791-1872) est interprété par quatre comédiens au jeu très physique, dans une mise en scène de Karin Beier qui combine une rigueur formelle et une profondeur psychologique absolument bouleversante.
Festival Le Standard Idéal, 7eme édition
Du 29 janvier au 19 février 2010
MC93 Bobigny
1 bd Lénine, 93000 Bobigny
www.mc93.com
Read More →
« Silence, on tue ! » d’Armel Mandar
// Jan 16th, 2010
Lecture de Plume –
Laure, compagne de François, est une jeune femme entourée d’amis. On la sent tourmentée, sur les nerfs, voire exaspérante. Pourtant, François sait la calmer et lui parler. Mais le mal-être de Laure l’emporte sur toute approche affective, raisonnable, amicale jusqu’à… l’aveu. Une habile alternance de scènes anciennes et actuelles nous guide vers l’innommable, à savoir l’inceste infligé à Laure par son père, en pleine adolescence. Elle s’en ouvre enfin à François. Son entourage se divise sur la question de la plainte à déposer contre l’agresseur, si longtemps après. Tandis que la famille proche marque son étonnement ou sa réticence, François et les amis encouragent la victime à le dénoncer. La scène finale, remarquable dans son argumentaire, est criante d’authenticité objective. Par ce procès, chacun est à sa place, chacun est entendu, et Laure, libérée du poids de cet immense non-dit, peut renouer avec la vie.
Armel Mandart aborde avec concision, réalisme, et justesse, l’un des thèmes les plus difficiles qui soient à porter devant un public. Fort de son expérience de psychologue clinicien, doublée de celle d’expert auprès des tribunaux, l’auteur partage son point de vue éclairé sur la question, avec finesse et générosité, sans jamais tomber dans la didactique, nous faisant comprendre que si l’innommable se repaît de l’indicible, si le silence tue plus que tout, la prise de parole, accueillie, épaulée, délivrée est opérante au-delà du révélé.
L’aînée
Laure est l’aînée. Lorsqu’elle voit que son père commence à vouloir agir de la même ignoble façon avec sa petite sœur, elle le rapporte alors à sa mère. Jusqu’à présent, le comportement du père est « intégré » à son quotidien. Laure, en grande souffrance, a bien tenté une fois d’en parler à mi-mots avec une adulte de confiance, son professeur de musique, mais l’incompréhension est totale. La question étant de savoir si cette dame est aimée de son père, et cette dernière répondant « Bien sûr qu’il m’aime. Pourquoi me demandes-tu ça ? », ceci fait alors écho aux paroles du propre père de Laure « Tu sais, tous les pères font ça à leur petite fille…quand ils aiment leur petite fille ». Comment l’enfant pourrait-elle soupçonner que cela se passe ailleurs autrement ? Et ce n’est qu’un des pièges de la capacité manipulatrice de tout abuseur.
Aliénée ?
L’adolescente, mise à la porte « à coups de gifles », va se réfugier chez ses grands-parents maternels. La vie à la maison auprès d’un père incestueux et d’une mère, qui veut continuer d’être épouse plutôt que de croire sa fille, est insupportable. Mais les grands-parents eux-mêmes « ne voient pas le mal », cet homme est « si charmant ». On (famille, amies) préfère croire que la petite est « lunatique », « spéciale », d’ « humeur changeante », « bloquée », qu’elle a mauvais caractère… Un coup de folie ? Il est tellement plus simple de préjuger de la folie chez une victime que de dénoncer le coupable. Et les pièges (chantage, secret, aveuglement, déni…) se refermant sur elle peuvent en effet l’emporter. Armel Mandart souligne cette probable aliénation, si le silence-roi perdure, par le subtil procédé de la superposition. Ainsi des scènes du passé et du présent, quasi jumelles, s’entrelacent, expliquant les réactions actuelles de la jeune femme. Bien vite, un fondu enchaîné nous place devant une super pose, relai entre la gestuelle affectueuse des amoureux et celle, contre nature, du père pour l’adolescente. Nous comprenons donc immédiatement que le couple Laure-François reproduit à son insu la tendresse tronquée d’antan entre père et fille, d’où la non circulation harmonieuse de l’amour entre la jeune femme et son compagnon. Et si la victime ne déchiffre pas ces superpositions, l’aliénation la guette.
Alien et… ?
Armel Mandart, auteur exigeant, pousse judicieusement l’observation jusqu’à débusquer l’« alien » dans la victime comme dans le bourreau. L’alien est l’« étranger », cet autre en soi qui peut se substituer à lui et le condamner à vie. Quand une enfant comme Laure subit l’inceste, elle n’est pas elle-même. Lorsqu’elle le réalise, se croyant coupable, elle se traite de « salope », « putain » dans son épanchement envers François. De toute évidence, elle a été niée, soumise, salie, « tuée ». Ses comportements adultes sont déroutants, voire périlleux, pour elle comme pour l’entourage. Et une victime, peut lover cet « alien » sa vie durant, si aucun secours ne lui est offert. Son père ne niera rien au procès. Il expliquera qu’il était « hors de lui », que c’était « un enfer » pour lui aussi et qu’il a « été soulagé quand Laure est partie de la maison ». Auparavant, au cours d’une scène, on le voit dialoguer avec son médecin, auquel il tente d’expliquer cet être en lui qu’il abrite et le dépasse mais… le médecin ne veut rien entendre de cet ordre-là. Laure elle-même dit de lui « Je revois sans cesse ses yeux qui sortaient de sa tête, des yeux de fou furieux » ou encore « le monstre et le gentil…les deux en un ». Cela ne dédouane aucunement l’abuseur, mais l’inscrit dans une histoire à connaître.
Et l’auteur démontre que la rupture du silence est salvatrice. La parole chasse l’ « alien » et… restaure.
Elle est « née »
Cette pièce montre que l’abus est autant du côté de l’acte que du silence plaqué autour et par beaucoup… Laure va parler, puis dénoncer, puis porter plainte, se faire aider psychologiquement, découvrir sa véritable identité et enfin retrouver un chemin d’amour et de vie. Laure, à la barre, termine son intervention par le désir d’avoir un enfant de François. Le projet-même du désir est un signe de délivrance. Enfin, elle est née !
Un texte émouvant, lucide, plein d’espoir, qui a conquis les scènes de province et cherche aussi une oreille parisienne… une quête… capitale, non ?
Silence, on tue !
D’Armel Mandart
Editions Les Mandarines
Kergouarec, 56400 Brec’h
http://lesmandarines.free.fr
Read More →
« La Ronde » d’Arthur Schnitzler mis en scène par Marion Bierry
// Jan 16th, 2010
Critique d’Hervé Mestron –
Du sexe à l’époque de Freud
Arthur Schnitzler (1862-1931), médecin, s’est intéressé à la psychiatrie, à la dermatologie, et aux maladies vénériennes. Forcément, il a dû en voir et en entendre. Ces questions ont dépassé le cadre strict de ses consultations pour nourrir son imaginaire et donner de l’encre à son scalpel. La Ronde se présente sous la forme de dix scènes ayant pour dénominateur commun la vitalité de la virilité galonnée. Nous sommes en 1900, c’est dire si les hommes sont en forme.
Il n’y a ni début ni fin dans cette histoire. C’est une ronde, et on a l’impression d’entendre la musique de la terre, la passacaille de la roue qui tourne, inlassablement, jusqu’à se répéter sans évolution notoire, comme un coït ad libitum. En dix séquences, la pièce raconte la relation intime mais aussi sa résonance sociale. En partant de la prostituée, on rencontre des acteurs de toutes les classes de la Vienne de 1900. Militaires, gradés, gens de la bourgeoisie. Séduction, pouvoir, argent. Il y a ce thème éternel de la pensée hommasse populaire : la pute au grand cœur, la bourgeoise qui capitule, l’artiste au corps sublimé par la prière, et le gars, lui, toujours présent, le même sous des masques multiples, tirant bravement son coup de fusil avec un désastreux panache, dont l’écho restitue sans fin la frénésie des corps assoiffés.
Le tempo de la Ronde
Certains dans le public ont beaucoup rit, ma voisine de gauche notamment. Certains se sont peut-être reconnus dans le miroir de la pièce et, de peur de rougir dans le noir, ont préféré pouffer. Humour noir, non, pas chez Schnitzler. Acreté et précision de la langue. Maîtrise de la forme séquencée parcourant le tableau vivant d’une société en goguette. Pas d’éclat. Seulement des obus. Et ce rythme joyeusement orchestré par Marion Bierry, faisant tourner les numéros comme sur une piste de cirque, avec des personnes parfois nues sur scène, si si. Subtil clin d’œil à l’échelle des censures. Effet cabaret garanti, mais décalé, dans un écrin scénographique ingénieux.
La Ronde
De : Arthur Schnitzler
Mise en scène : Marion Bierry
Avec : Vincent Heden, Alexandre Martin, Sandrine Molaro, Serge Noël, Marie Reache, Aline Salajan, Eric Verdin.
Assistant à la mise en scène : Denis Lemaitre
Décor : Nicolas Sire
Costumes : Virginie Houdinière
Lumières : André Diot
Du 11 décembre 2009 au 28 avril 2010
Théâtre de poche Montparnasse
75 bd du Montparnasse, 75 006 Paris – 01 45 48 92 97
theatredepoche-montparnasse.com
Read More →
Copyright © 2009 Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales parisien.
All rights reserved.


 Billet des Auteurs de Theatre
Billet des Auteurs de Theatre Editions Mandarines
Editions Mandarines Paroles francophones
Paroles francophones Théâtre du Rond Point
Théâtre du Rond Point