« Les Lundis en coulisse » de l’Aquarium
// Jan 15th, 2010
Premier rendez-vous
L’écriture théâtrale contemporaine intéresse, intrigue, suscite l’engouement ou la curiosité et il est parfois difficile d’en apprécier toutes les subtilités. Dans le cadre des « Lundis en coulisse », le Théâtre de l’Aquarium ouvre ses portes le lundi 18 janvier de 14h00 à 19h00, pour le premier rendez-vous de cet évènement qui aura lieu chaque mois.
Découverte de textes nouveaux, proposés par un invité et lus par tous les curieux, passionnés ou amateurs d’écriture théâtrale contemporaine.
Pour ce premier rendez-vous, l’Aquarium invite Gislaine Drahy (metteure en scène et directrice de la compagnie lyonnaise « Théâtre Narration ») qui dirigera ces premières lectures qui s’annoncent riches en découvertes et émotions partagées.
Bruno Deslot
« Lundis en coulisse »
Lundi 18 janvier 2010 de 14h00 à 19h00
Invitée Gislaine Drahy
Entrée libre – Réservations au 01 43 74 72 74
Théâtre de l’Aquarium
Cartoucherie
Route du Champ de Manœuvre
75012 Paris
www.theatredelaquarium.net
Read More →
Atteinte à la liberté d’expression !
// Jan 15th, 2010
Une agression inadmissible
L’agression de Rayhana, auteure et comédienne d’origine algérienne, aspergée d’essence alors qu’elle se rendait à la salle parisienne où elle donne un spectacle sur des femmes algériennes, a suscité jeudi une vague d’indignation. Cette artiste féministe de 45 ans a été agressée et aspergée d’essence mardi soir alors qu’elle se rendait à la Maison des Métallos où elle joue actuellement, avec huit autres actrices, sa pièce A mon âge, je me cache encore pour fumer. « Deux hommes sont venus et m’ont tenu par derrière. J’avais la tête baissée et j’ai reçu une giclée sur le visage. J’étais aveuglée. J’ai reconnu l’odeur de l’essence. Une braise a touché mon bonnet et j’ai couru« , a raconté la comédienne qui bénéficie depuis d’une protection policière. Rayhana indique avoir fait l’objet de premières menaces verbales le 5 janvier. « Deux hommes m’ont traité dans la rue de putain et de mécréante« , a ajouté Rayhana, qui avait déposé une première plainte après ces intimidations. Elle s’est déclarée décidée à poursuivre les représentations de sa pièce jusqu’à son terme pour montrer à ses agresseurs qu’elle n’a « pas peur d’eux » dans un pays « où il y a une liberté d’expression« . Evoquant le contenu de sa pièce, qui se déroule dans un hammam, l’auteure dit avoir situé « cette histoire à Alger parce que c’est ma culture« . « Je parle de femmes que je connais, d’une culture que je connais, mon propos ce sont les femmes en général », précise la dramaturge. Une liberté de ton qui n’est pas appréciée par les fanatiques qui s’obstinent à vouloir imposer, par des actes barbares, la violence que leurs idées rétrogrades encouragent. Cet acte scandaleux et inqualifiable est inadmissible sur notre territoire. Rayhana est reçue aujourd’hui par la Secrétaire d’Etat à la famille, Nadine Murano, qui lui manifestera son soutien. Les Ecrivains Associés du Théâtre, ainsi que toute la profession, soutiennent l’auteure éprouvée par l’obscurantisme d’une société qui ne doit pas semer la terreur en invoquant les prophètes de la dérive !
Bruno Deslot
Read More →

Critique de Bruno Deslot –
Sur les traces d’une histoire trop commune
Une femme se raconte, s’interroge et tente de bousculer les diktats de l’idéal féminin, imposés par une société patriarcale.
Magie de l’artifice, merveille de la cosmétique, alimentation saine et équilibrée, confortent la femme idéale dans une image de perfection « parce qu’elle le vaut bien » ! Le ton est donné à une création émaillée des poncifs de la représentation féminine dans une société bourgeoise, qui dompte le corps invaginé des ces créatures victimes d’elles mêmes. La grossesse, l’accouchement, le statut de mère, ça, dont elle ne peut faire l’économie et enfin l’image repoussante et caricaturale de celle à qui elle ne voudrait pas ressembler, « la pétasse », constituent les fondations fragiles d’un édifice qui se veut être en perpétuelle évolution. Au micro, en voix-off ou dans un rapport direct au public, Carole Thibaut, s’épanche, se livre, s’interroge, tente de dessiner les contours de son identité de femme. Expulsant une chose improbable à laquelle il faut donner le sein, parcourant ses formes généreuses pour mieux s’en affranchir, caressant le phallocentrisme de manière clitoridienne afin de refuser la soumission au « sexe fort », les images se succèdent, s’enchaînent au rythme des spots publicitaires défilant sur les écrans aux heures de grande écoute. De la private jock au clin d’œil vastement consensuel et fédérateur à propos de la femme d’aujourd’hui, les propositions s’organisent comme le plan d’une dissertation, dont les tiroirs usités, situent la production à un niveau de réflexion qui ne risque pas de mettre en péril la pensée stérile d’une jeune femme de bonne famille, qui s’encanaille tout de même en évoquant des faits poignants, semble-t-il !
La mise dans l’abyme
Auteure de cette création, Carole Thibaut interroge la femme qu’elle est à la lumière d’une société qui a toujours considéré le genre féminin comme une moitié d’humanité. A la recherche d’une histoire commune aux femmes et qui ne serait pas écrite par les hommes, l’auteure tente de raconter, dans une dimension intimiste plus qu’intime, ce qui pourrait dessiner les contours de son identité de femme. Dix modules, pour aborder l’idéal féminin engagée dans une quête existentielle en proie à un malaise sociétal, échafaudent avec une mise à distance toute relative, la structure fragile de cette création. Une scénographie élégante et sophistiquée dans un théâtre de fortune, tente de donner toujours plus de crédit à une véritable course menée vers l’abyme. Un parterre argenté, habillé, de part et d’autre, d’un éclairage délicat, permet à la femme idéale de pénétrer l’arène de ses interrogations. A l’avant de la scène, un pupitre, appareillé de pédales, qui permettent de faire retentir la pensée intérieure de la comédienne par l’intermédiaire d’un micro, constitue un espace dans lequel la parole est libérée comme en rêve. Situés en fond de scène, des miroirs placent le propos entre fantasme et réalité, jouant la carte de la mise en abyme, davantage évidente que suggérée. La femme idéale se disloque, s’étiole dès lors qu’après s’être livrée à un jeu d’expression corporelle, elle découvre la maternité, la douleur des premières règles et ça, indéfinissable énigme qui gît entre ses cuisses béantes. Excellente comédienne, Carole Thibaut perd en crédibilité ce qu’elle tente de gagner en réflexion sur l’idéal féminin, un thème vendeur et fédérateur dans une période de grand bouleversement, comme elle l’affirme.
Fantaisies – l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était !
De, mis en scène et avec : Carole Thibaut
Assistanat à la mise en scène : Fanny Zeller
Travail sur le corps : Philippe Ménard
Création technique et lumières : Didier Brun
Décor : Yves Cohen
Création sonore : Pascal Bricard
Costumes : Magali Pichard
Compagnie Sambre
Du 14 au 30 janvier 2010
Confluences
190 bd de Charonne, 75 020 Paris
www.confluences.jimdo.com
Voir aussi :
La rencontre avec l’auteure, metteure en scène et comédienne Carole Thibaut
Read More →
« Saint-Germain-des-Prés Dandy », création de Isée St John Knowles au Théâtre Mouffetard
// Jan 14th, 2010
Critique de Marion Ploquin –
Une galerie de portraits
Sartre, Limouse, le dandysme, Boris Vian, le bee bop. Un peu plus d’une heure de spectacle qui nous plonge dans l’atmosphère exaltante du Saint-Germain-des-prés Baudelairien…
La pièce s’ouvre sur l’Akadémie Duncan qui, en 1957, s’apprête à célébrer le centenaire des Fleurs du mal sur le thème du dandysme. L’autonomie de la pensée est une valeur inhérente aux baudelairiens, qui se battent pour défendre leurs convictions et résister à l’oppression.
Cette notion est illustrée par une succession de tableaux évoquant chronologiquement l’histoire et le devenir de Saint-Germain-des-Prés. Il y a d’une part, les membres de la société Baudelaire, réunis autour de Raymond Duncan. Et, les personnages incarnés dans les différentes scènes qui reviennent sur certaines prises de position caractéristiques de l’état d’esprit du Dandy. On y découvre, entre autre, la fille de Limouse qui décide à l’occasion d’un récital donné à l’akademia, d’être accompagnée par sa pianiste juive, alors défendue d’exercer sa profession. Les ambiances et les périodes se juxtaposent retraçant l’épopée de Saint-Germain-des-Prés, de son apogée à sa déshérence.
L’identité de ce quartier se dessine clairement au travers d’une ambiance entraînante, nourrie par des interventions musicales et chantées. On accompagne volontiers le personnage de Pamina en reprenant avec elle les refrains de Boris Vian. Cette légèreté n’atténue pas pour autant l’importance de l’hommage fait à un Saint-Germain-des-Près aujourd’hui disparu. Le bémol : la scénographie un peu maigre et désuète qui contraste et dessert le dynamisme des seize comédiens en scène.
Saint-Germain-des-Prés Dandy
Ecriture et mise en scène : Isée Saint John Knowles
Avec : Frédéric Gay, Arnaud Bruyère, Denise Dax, Cécilia Word, Serge Martinez, Delphine Lascar, Valérie Lentzner, Pamina, Frédéric Roger, Philippe Davenet, Jean-Louis Stanek, Joseph Gallet, Franck Jouret, Philippe Cabasset, Michel Dury, Chryssa Florou, Natacha Bordaz, Cécile Coutin, Roger Pouly, Guillaume Delaunay, Emma Santini, Noémie Stevens, Ambre Vérot
Les 13, 14 et 16 Janvier 2010 à 19h
Dans le cadre du Festival Saint-Germain-des-Prés Baudelairien
Théâtre Mouffetard
73 rue Mouffetard, 75 005 Paris
www.theatremouffetard.com
Read More →
« Oncle Vania » de Tchekhov au Théâtre 14
// Jan 14th, 2010
Critique de Camille Hazard –
L’inertie ravageuse
Comment vaincre l’incapacité d’agir ? Comment vivre, éloigné de toute réalité sociale, sans repère, sans amour, sans force ? Tchekhov nous met à la place d’un scientifique qui observerait au microscope, les membres d’une famille tentant de survivre jour après jour.
Le renommé professeur Sérébriakov et sa jeune épouse Eléna passent leur été dans la maison d’Ivan VoÏnitsky (frère de la première femme défunte de Sérébriakov). Ils y rejoignent Sonia, la fille du professeur, Astrov un médecin de campagne usé par le travail et qui n’aime personne, Téléguine, dit « la gaufre », un propriétaire terrien ruiné et enfin Maria, la mère d’Ivan, qui passe toutes ses journées à lire et à étudier des brochures littéraires. Au fur et à mesure des jours fatigués qui s’écoulent, une tension haineuse se crée entre Vania et Sérébriakov. En effet, Oncle Vania et Sonia ont exploité toute leur vie le domaine pour en envoyer l’argent au professeur dont ils admiraient l’intelligence et le travail. Mais, en plus d’être doué, d’être riche, le professeur a surtout une jeune épouse dont sont follement épris Vania et Astrov . Par la voix de l’auteur, ils s’interrogent sur le lien qui unit l’argent, l’amour et le bonheur et tentent de comprendre pourquoi rien ne leur arrive.
Un monde à réinventer
La traduction d’Arthur Adamov propose des phrases enlevées, piquantes tout en gardant la force d’un vocabulaire exigeant. Les personnages sont en proie à des faits extérieurs sans jamais s’y accrocher et demeurent dans une inertie morbide. La pièce, Oncle Vania, se concentre autour de la Parole : les personnages ont recours aux souvenirs, aux complaintes, se réfugient dans le discours ; ils cherchent à masquer le vide qui les rapproche de la mort.
On apprécie tout d’abord le jeu des comédiens et la finesse de la mise en scène. On retiendra tout particulièrement l’acteur Jacques Angéniol qui propose un Téléguine décalé, hors quotidien, qui nous rappelle un peu un des personnages phares de Beckett, timide, désorienté, enfantin… Et Liana Fulga dans le rôle d’Eléna. Délicieuse « cruche » qui a conscience de son inutilité, qui n’est plus amoureuse de son mari mais qui a une force extraordinaire à survivre, complètement exaltée… On aurait pu juste espérer une Sonia moins « maniérée » , car cela enlève du poids au personnage que l’on plaint du coup moins facilement. Oncle Vania, interprété par M.Maréchal, est plein de couleurs, parfois enfant gâté, parfois homme vieillissant, grincheux, il passe d’un registre à un autre avec beaucoup de talent.
Un décor sobre, blanc qui fait office de terrasse, de chambre à coucher ou de salon. L’espace des pièces est créé par des portes donnant sur le vide, figurant une sorte de labyrinthe où il est bien difficile de se rencontrer. Au fond de la scène, de longues planches de bois se croisent tout en restant droites et verticales ; elles font écho à la fragilité en même temps qu’à la rage de vivre de ces personnages. Tout au long des cinq actes, un personnage revient, épiant les scènes, jouant un air populaire à l’accordéon. Cet ouvrier symbolise les événements sanglants de 1905 (la mutinerie des matelots du Potemkine) soulignant ainsi l’esprit visionnaire de l’auteur. La pièce s’achève sur ce motif musical comme un couperet pour cette classe bourgeoise qui ignore tout du peuple.
Bien que le texte dramatique soit finement mis en scène, on regrette que M. Maréchal et M.Demiautte n’aient pas osé explorer plus profondément les ressacs du désespoir et de l’inertie propre à Tchekhov. Il y des moments très drôles mais qui auraient pu être aussi grinçants car les personnages ont tous atteints le seuil de leur limite à vivre. M.Maréchal donne beaucoup de rythme aux scènes, beaucoup d’humour, mais l’on ne ressort pas avec le cœur qui bat, ni avec les mains moites, on ne vit pas sur notre fauteuil ce que les personnages endurent sur scène, même si l’ensemble de la pièce est convaincant.
Oncle Vania
De : Anton Tchekhov
Traduction : Arthur Adamov
Mise en scène : Marcel Maréchal et Michel Demiautte
Avec : Olga Abrego, Jacques Angéniol, Antony Cochin, Emmanuel Dechartre, Michel Demiautte, Juliette Duval, Liana, Marcel Maréchal, Hélène Roussel
Dramaturgie : François Bourgeat
Assistant à la mise en scène : Antony Cochin
Musique : François Fayt
Décor : Thierry Good
Costumes : Bruno Fatalot
Lumières : Jean-luc Chanonat
Régie : Hugo Richard et Pierre Daubigny
Habilleuse : Christelle Yvon
Du 12 janvier au 27 février 2010
Théâtre 14 Jean-Marie Serreau
20 avenue Marc Sangnier, 75 014 Paris
theatre14.fr
Read More →
Rencontre avec le metteur en scène Patrick Zuzalla
// Jan 13th, 2010
une rencontre de Bruno Deslot –
Fort de son succès lors de la saison dernière à la Maison de la Poésie, Philoctète et ravachol est repris à partir du 20 janvier 2010 à la Maison de la Poésie. Ravachol, anarchiste français, mort guillotiné à 33 ans en 1892. Philoctète, héros grec abandonné sur une île déserte par Ulysse et ses compagnons. Deux personnages qui exposent leur solitude à une enquête intransigeante sur la condition humaine. Ecrit par Cédric Demangeot, remarquablement interprété par Damien Houssier, cette création est mise en scène par Patrick Zuzalla.
Dans ses deux poèmes sur Philoctète et Ravachol, Cédric Demangeot dit avoir traité les deux personnages à égalité et parle, à ce titre, d’une poétique de la juxtaposition assumée. Comment vous êtes vous approprié cette juxtaposition pour la mettre en espace ?
Patrick Zuzalla : L’idée de la juxtaposition vient de ma vision du poème ravachol. Ce personnage est constitué d’une succession de parties plus juxtaposées que liées entre elles. Dans un premier temps, ayant travaillé ravachol seul, Cédric m’a donné à lire Philoctète qui m’est apparu comme un élément qui venait se coller à ravachol. D’où l’idée de cet enchaînement, qui pourrait tout à fait s’inverser d’ailleurs. Je parle de juxtaposition car dans le premier poème de Cédric Demangeot, ravachol, je vois une succession de couches, un mouvement continu dans la première partie du poème puis un ravachol invaginé dans la seconde. Ces deux parties fonctionnent vraiment comme deux couches superposées avec deux façons de fonctionner, d’expérimenter, de reconstruire l’être de ce personnage. Une fois que la partie magique, qui est celle de invaginé ravachol a explosé, soit on est face à une fin, une clôture, soit on peut considérer que l’être se remet en marche pour tenter un redémarrage. Cette lecture du personnage nous a tenté et c’est pourquoi Philoctète prend la suite et que le comédien se relève, se remet en faculté de jeu, réinvente un espace, un costume avec ce qui étaient ses outils dans la première partie pour repartir dans un autre univers et peut être ainsi ajouter une couche qui serait un entrelacement des couches précédentes. D’un point de vue scénographique, mon souci a été de construire un espace d’expérience, voire d’exposition comme un lieu où l’on expose un beau tableau ou une carcasse éventrée. Cela peut être du Delacroix comme du Bacon. C’est donc dans ce sens, que les quelques outils de jeu dont le comédien se sert, se sont imposés dans le travail.
Philoctète a en commun avec Ravachol d’être un grand « raté ». Cédric Demangeot dit s’emparer de ce « raté » pour faire de ces deux personnages, une figure exemplaire de la résistance. Quel est votre point de vue à ce sujet et comment vous en êtes vous emparé pour mettre en scène Philoctète et ravachol ?
PZ : La réécriture de la fin du mythe connote, de façon beckettienne, le personnage de Philoctète et en fait un « raté », en tout cas quelqu’un qui n’a plus qu’un peu de force pour aller vers la solitude, pour puiser un peu d’humanité. Philoctète et Ravachol sont deux figures de résistance et en même temps de mise en garde. Chez Philoctète, il y a cette belle figure de résistance qui choisit de rester seul sur un île, fuyant les autres. On peut, à ce titre le rapprocher d’un Timon d’Athènes ou d’un Alceste qui, à un moment donné, choisit le désert. Il y a aussi cette violence, perpétuellement présente et revendiquée que l’on transforme par les mots et par la langue pour, peut être, éviter un passage à l’acte brutal. Malgré cette transformation, la violence est présente et pèse comme la menace permanente d’un dérapage. C’est en quelque sorte, une analyse de l’anarchie, une façon de montrer que la résistance désespérée ne mène pas à grand-chose.
Par quels procédés scénographiques avez-vous donné une dimension résolument contemporaine à Philoctète et ravachol ?
PZ : C’est une question que l’on se pose toujours. Faut-il être contemporain ou pas ? Je ne vais pas éluder la question mais j’ai envie de dire que c’est une question que l’on ne s’est pas énormément posée. Nous n’avons pas cherché à rendre les deux poèmes contemporains, mais nous avons cherché à savoir comment nous allions permettre de proposer un travail qui pose les questions essentielles du théâtre, comme la manière dont le comédien s’approprie la langue. Dès lors, le plateau devient un lieu d’exercice et d’expérience et je préfère que les images se constituent à partir de cette question la. Celle de savoir comment appareiller le comédien pour lui permettre d’atteindre la langue à son plus haut niveau. A partir de là, les outils s’imposent plus ou moins, ils font partie de l’exercice, puis on les retient pour passer le cap de la répétition pour aller construire l’image sur le plateau. C’est comme cela que les choses se sont élaborées. Il y a une dimension d’exposition dans ravachol, d’où ce lieu de dissection éminemment corporel, avec ce rapport au sang, à un récipient qui contient cette matière, faisant référence à la marmite que Ravachol dépose au domicile du président Benoît. Un bâche, déposée à même le sol, est une manière de parler de violence sans jamais donner l’impression de salir. L’acteur se sert énormément de cette bâche comme appui et cet outil scénographique devient un costume pour le comédien qui passe à l’autre personnage, qui est Philoctète. Dès lors, la translation devient intéressante. La marmite devient le compagnon fidèle du personnage mythologique, et est utilisée comme un outil du paysage. Philoctète parle de la grotte en montrant la marmite, par exemple. Les outils qui restent en scène, y sont car ils permettent de démultiplier les images et au comédien de proposer un dégradé des angles.
Le poème de ravachol est composé à la manière d’un ready-made. Exploitez-vous cette dimension esthétique dans votre travail ?
PZ : Déjà, au niveau du jeu, cela permet de saisir la démarche du poète et donc de la mener à bien, dans le théâtre aussi. Le fait que les trois quarts du poème de ravachol soient constitués des Mémoires de l’anarchiste, Ravachol, dans lesquelles il raconte sa vie aux gardiens de la prison, soient également composés d’éléments du procès, cela m’a permis, à l’opposé des objectivistes américains, d’observer une démarche subjectiviste. Je n’ai travaillé que la matière de ravachol en y ajoutant rien, ce qui permet de réaliser une poésie en excès d’être. La dimension supplémentaire dans le ready-made, sur tous les premiers mouvements de ravachol, c’est de constituer une arme contre toute psychologisation du personnage ou de cette destinée. C’est quelque chose qui impose très vite la question du rythme du poème, puisque les différentes petites parties sont intitulées roman en vers, et de façon maladroite, nous retournons aux origines de la langue en France, c’est-à-dire, au récit de l’époque médiéval. Nous sommes, du coup, dans une épopée maladroite, ou d’un être « raté » qui rapporte tous les épisodes de sa vie et le rythme qui raconte cela, essaye d’épouser ce destin. Nous sommes dans un récit qui s’appuie sur des faits biographiques contrebalancés par une prosodie extrêmement travaillée, permettant d’être toujours en regard ou en accompagnement de ce personnage.
La nudité est un choix de mise en scène de votre part, que Cédric Demangeot a très bien compris et accepté. Au théâtre, la nudité a suivi l’évolution d’un parcours qui est allé de la révolte à la normalité. Ne craignez-vous pas que la nudité du comédien banalise le propos ?
PZ : C’est en effet le danger ! Soit on décide que le théâtre permet toutes les formes d’expressions possibles et l’on décide de n’en mettre aucunes de côté, donc la nudité est une possibilité de travail, soit on se dit qu’en effet aujourd’hui, c’est rentrer dans une forme d’esthétisme sans grand intérêt. Nous avons fait le choix de travailler la nudité, à un moment du spectacle, car cela nous paraissait nécessaire. Ce qui mène mon travail au théâtre, c’est l’implication inévitable du corps et de la langue. Le théâtre est le seul art vivant qui permet à la langue de prendre corps et inversement, ce qui peut être perçu comme particulièrement indécent. Lorsque l’on expose la langue à un niveau d’exigence tel que celui du théâtre l’impose, c’est forcément pour nous mettre face à un miroir et ainsi nous interroger. Dans ce spectacle, la nudité est un souci de revendiquer cela, comme une forme d’exposition et non d’exhibition. Plutôt que d’écrire des manifestes ou de long discours sur la nudité au théâtre, il est préférable que ce soit la représentation qui mette cela en jeu. C’est pourquoi la nudité est essentielle dans ce spectacle.
Voir l’article
Philoctète et ravachol
De : Cédric Demangeot
Mise en scène et scénographie : Patrick Zuzalla
Du 20 janvier au 14 février 2010
Maison de la Poésie
Passage Molière
157 rue Saint-Martin
75 003 Paris
www.maisondelapoesieparis.com
Read More →
« Vestine, une légende noire » de Virginie Jouannet Roussel
// Jan 13th, 2010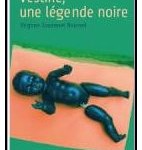
Lecture de Plume –
La jeune Mukagatare est une survivante de génocide rwandais. Adoptée par une famille alsacienne, Vestine, car tel est le prénom qu’elle choisit et emporte, juste avant la fuite, fait tout son possible pour s’adapter à son pays d’accueil. Mais surtout, pour ne pas être une mort-vivante, elle s’efforce de retrouver la mémoire de sa tragédie, dans un monologue poignant, lucide et envoûtant.
Du monologue sous l’hybride
Ce texte, non autobiographique, qualifié de légende dès son titre et débutant par la marque du conte « Il était une fois, ma jambe de bois » -presque une histoire de poupée- est en fait un vrai monologue dialogique, avec apostrophes aux personnages (sa mère, sa Petite Sœur), comme au lecteur/spectateur (ex. « Faites le calcul », « ça semble bizarre, non? »), onomatopées (« Vlan »), temps de l’énonciation, inclusions ponctuelles des temps du récit, effets de réel… Vestine vous fait face, vous n’entendez qu’elle et, malgré le rapport de l’inconcevable, vous ne détournez pas les yeux, tant cette « légende noire » (recomposition de son histoire de fuite nocturne escortée de morts) vous interpelle. Et si « les pères nègres ne font pas bon ménage avec le complexe de Cassandre », les filles en exode, noires comme leur légende, semblent traversées par une mythologie universelle, qui, dans leur exil, nous rattrape tous, quelles que soient nos origines.
De Janus ou des antagonismes
Si Janus est la figure du Chaos, les terres, les épreuves, les gens abordés par Vestine présentent tous une double face, même ce qui paraît le plus inoffensif. La langue, le prénom, si intimes, peuvent vous trahir. Il faut les oublier, en changer, pour continuer de vivre. Tout ce qui semble amical devient hostile dans ce contexte ravageur. Le monologue commence par un franc rire de Vestine et de Nine, son amie alsacienne, à propos de la jambe de bois, prothèse de la petite africaine, à décoincer. Ce « fou » rire fait écho au rire des guerriers « fous » de là-bas. Devant Vestine, les soldats tuent en riant, si bien que ceux qui viendront la sauver in extremis, en souriant, seront pris pour les « mêmes ». La forêt, abri des civils, se transforme en cauchemar de nudité, lorsque les hommes, poursuivis par la terreur, coupent plus d’arbres qu’il ne faudrait pour les huttes. Et puis l’ombre, l’ombre aimée, mouvante dès l’aube et sécurisante, l’ombre des siens, se métamorphose en ombres indéchiffrables des cadavres recroquevillés.
Lorsque l’arbre ne cache plus la forêt, que le visage devient masque unique et que l’ombre silencieuse porte une odeur, les repères explosent dans la duplicité.
De Pandore ou se souvenir des horreurs
En France, sous la conduite bienveillante d’un thérapeute, Vestine doit, au péril de sa santé mentale, « se souvenir ». La quête de son identité est laborieuse, douloureuse, équivoque, car les souvenirs sont si durs à faire surgir, qu’il faut « colmater » les trous de la mémoire, béquille mentale, jumelle de la prothèse, pour renouer avec le réel. Elle, ce n’est pas des belles choses dont elle se souvient, mais de l’horreur de sa traversée, de sa famille trucidée, des agonisants, du mélange des corps à terre, de ce qu’elle a subi aussi dans sa propre chair, des coups semblables portés entre eux par les Tutsis et les Hutus, de la tragédie du camp de Kigali, de la marche incessante comme mode de survie, des bébés « tambours », puis « rouges », puis petits tas rigides, morceaux d’ombres égarées, bouts de néant.
Son cerveau est une boite de Pandore, où le mensonge, mal nécessaire, est un moindre mal.
D’ Orphée ou s’entraîner à mourir
Pendant sa fuite première, avec encore sa mère et sa fratrie, Vestine tombe sans explication dans une sorte de coma où elle se sent « flotter en l’air ». Sa mère, guérisseuse, parviendra à la sauver par le feu. La petite reviendra à elle. Plus tard, elle considèrera cet épisode comme un entraînement secret à franchir la mort. Dans sa seconde fuite, seule au monde, tenant dans ses bras sa toute petite sœur vagissante, elle sera laissée pour morte par les soldats, dont la sauvagerie est incontournable. Ayant intériorisé l’approche de la mort auparavant, elle la feint et… s’en sort.
C’est comme si elle ne prenait d’Orphée que le goût de la mort, son flirt avec elle, mais qu’elle savait garder la distance nécessaire à sa remontée parmi les vivants.
De Mnémosyne ou revenir à la source
« Les hommes sont égarés sur la terre. Ils cherchent, ils tuent, ils aiment, ils rêvent, mais un jour ils reviennent à la source. » Le travail de reconstitution de Vestine s’étend sur des années. Sa « légende », récit bigarré, fait de souvenirs authentiques et recomposés, s’étoffe progressivement. Un jour, elle se souvient de beaucoup. Pour cela, elle prend « d’autres images pour affronter… » sa légende, en particulier une image positive de sa mère, sa source…
En s’adonnant à cet « affront » perpétuel, comme si elle remontait vaillamment les courants de la Titanide Mnémosyne, elle œuvre courageusement à son identité.
Vers une petite Hermès ou le message de l’amour en marche
Vestine, ne cesse de nous conter sa marche. La marche est toute son histoire. On pourrait dire que, se détachant du chaos, saluant alors en Janus seulement sa prudence, secouant l’espérance au fond du coffre de Pandore, détournant la maladresse d’Orphée, respectant l’amer sillage de Mnémosyne, elle ne cesse de marcher avec une obstination créatrice dans ce monde qui détruit autant qu’il façonne. Ce texte se termine par un inachèvement prometteur : « Ma légende me pousse vers l’horizon et je marche, je dépasse les ombres, je marche, je marche. »
Et cette jeune Hermès, se dépassant, devient messagère des routes de la vie. Le message est un message d’amour, forgé dès l’hôpital, dans la « contemplation » des béances semblables. Une jambe en moins pour elle, un trou dans le crâne pour une fillette du clan opposé, sa voisine de lit, et pourtant : « Nous sommes amies comme ça. »
Un monologue, magnifique, un monologue road-movie, qui cherche son interprète, son metteur en scène, son théâtre. Un monologue, qui souligne que la résonnance des massacres supplante les idéologies et le temps, mais que les enfants « en marche » transcendent le pire, quand on recueille minutieusement leur légende, qui ne nous est pas si étrangère.
Vestine, une légende noire
De Virginie Jouannet Roussel
Actes Sud Junior
18, rue Séguier, 75006 Paris
www.actes-sud.fr
Read More →
« La Fabbrica » d’Ascanio Celestini au Théâtre des Abbesses
// Jan 12th, 2010
Critique de Bettina Jacquemin –
Quand la réalité se nourrit d’histoires individuelles
Avec Fabbrica, Ascanio Celestini entraîne le spectateur dans les rouages de la réalité industrielle et politique de l’Italie du XXe siècle dont l’histoire est avant tout celle des ouvriers :
de Fausto, le chef manœuvre qui a perdu une jambe, de son père et de son grand-père qui portent le même prénom, de Paride Pietrasanta, patron de l’usine, d’Assunta, belle comme une Madone et au secret imprononçable et de tous ceux qui ont croisé leur destinée.
La Fabbrica est une usine en Italie. On y fabrique de l’acier. En 1949, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’industrie est en crise. Le narrateur tente pourtant de s’y faire embaucher. Il est accueilli par Fausto, le chef d’équipe qui a laissé sa jambe dans la fonte en fusion du haut-fourneau.
« C’est une histoire de famille de travailler à la Fabbrica ». Le grand-père de Fausto y travaillait déjà « quand les ouvriers étaient hauts de dix mètres ». Fausto, le père a, quant à lui côtoyé les ouvriers aristocratiques, ceux que le régime fasciste tolérait malgré leurs idées communistes ou anarchistes. Et, puis, il y a Fausto, fils et petit-fils de, clopinant et qu’on ne peut pas licencier.
Raconter le passé et s’interroger sur le présent
Le rideau s’ouvre sur celui qui, au travers d’une lettre écrite à sa mère raconte le réalisme industriel du XXe siècle, ses luttes syndicales ou encore la délocalisation.
‘’L’ouvrier-narrateur’’ raconte des histoires singulières pour mieux décrire l’Histoire, comme pour se souvenir… Se souvenir de ce qui est notre patrimoine, à tous. Ces usines fréquentées par nos grands-parents, nos parents parfois.
Alors, on se souvient… Et, on s’abandonne aussi, grâce notamment à Serge Maggiani dont l’interprétation du narrateur donne au récit une dimension encore plus humaine.
De cette réalité sociale, il s’en dégage une réelle poésie. Mais, les créations musicales chantées en italien interrompent trop souvent le récit. Malgré le talent des interprètes, il manque parfois de silence…
Attention, il ne s’agit pas ici de faire appel à une certaine nostalgie. La Fabbrica interpelle simplement sur ce qui nous façonne…
La Fabbrica
De : Ascanio Celestini
Traduction de l’italien : Olivier Favier
Mise en scène : Charles Tordjman
Avec : Serge Maggiani et Agnès Sourdillon
Chants : Sandra Mangini, Germana Mastropasqua, Giovanna Marini, Xavier Rebut
Jusqu’au 16 janvier 2010
Théâtre des Abbesses
31 rue des Abbesses, 75 018 Paris – 01 42 74 22 77
www.theatredelaville-paris.com
Read More →
« La Noce » de Brecht, mise en scène Patrick Pineau à la MC93
// Jan 11th, 2010
Critique de F. Fauvernier –
La pureté innocente du mariage battue en Brecht
En 1919, au sortir de la grande boucherie que fut la première guerre mondiale où il fut mobilisé comme infirmier, Bertolt Brecht à l’âge de vingt-et-un an, écrivit La Noce . Cette pièce était destinée à l’idole de Brecht, Karl Valentin célèbre soliste, parodiste et mime dans les plus fameux cabarets de Munich de l’époque. Oeuvre en 1 acte le plus souvent jouée sous son second titre plus politique La Noce chez les petits-bourgeois est à l’image de Karl Valentin, qui détruisait ses décors en même temps qu’il dynamitait les structures sociales.
C’est le déroulement d’un mariage chez des gens qui, pour citer Brel, « voudraient bien avoir l’air, mais n’ont pas l’air du tout ».
Un mariage burlesque où tout rate, où la bienséance et les apparences se noient dans l’alcool, révélant la noirceur des rapports humains que les sourires hypocrites n’arrivent plus à cacher…
Cette Noce qui devrait être l’un des moments les plus beaux de la vie, un moment d’harmonie amoureuse, voit son rythme peu à peu se désaccorder. Une noce ou les rapports entre les hommes se brisent aussi facilement que les meubles mal assemblés.
Une noce comme construite puis détruite à coup de marteaux.
Ça ne colle pas et le décor nous le rappelle sans cesse.
La Noce, charge explosive contre les conventions sociales, écrite il y a tout juste 90 ans, bénéficie ici d’une nouvelle traduction faite par Magali Rigaill, ce qui donne une nouvelle tonalité aux répliques courtes et percutantes du texte !
Patrick Pineau, le talentueux metteur en scène / Chef d’Orchestre de cette Noce, d’abord joyeuse, puis peu à peu funèbre, nous livre un spectacle tel un plan séquence en noir et blanc.
Sur scène, neuf comédiens dynamiques, aux échanges physiques, dans un décor sobre qui, au fur et à mesure de l’avancée de la pièce, jouera le premier rôle.
Ici, pas de sentiments, que du brut.
Le rouge des taches de vin, qui peu à peu, va consteller la table du banquet, comme des taches de sang giclant sous les répliques aiguisées.
Dans cette pièce, où tout peu à peu se brise, où les rapports humains s’écorchent, où les meubles se cassent car la colle est mauvaise, la célèbre formule de Jean Paul Sartre : « l’enfer c’est les autres » s’adapte idéalement.
La partition est d’autant plus agréable à voir et entendre que tous les comédiens sont admirables. Il y a une qualité d’écoute et une complicité formidable sur cette scène de Bobigny.
Si comme l’écrivait Bertolt Brecht, « La provocation est une façon de remettre la réalité sur ses pieds. », alors c’est chose faite dans le bouquet final de cette éclatante noce.
La Noce
De : Bertolt Brecht
Traduction : Magali Rigaill
Mise en scène : Patrick Pineau
Avec : Nicolas Bonnefoy, Hervé Briaux, David Bursztein, Laurence Cordier, Anne Fischer, Aline Le Berre, Laurent Manzoni, Babacar N’Baye Fall, Sylvie Orcier, Annie Perret, Régis Royer
Collaboration artistique : Anne Soisson
Conseil dramaturgique : Magali Rigaill
Scénographie : Sylvie Orcier
Musique : Jean-Philippe François
Costumes : Charlotte Merlin, Sylvie Orcier
Lumières : Gérard Gillot
Accessoire : Renaud Léon
Coiffure : Jocelyne Milazzo
Régie générale : Florent Fouquet
Du Samedi 9 janvier au 2 février 2010
MC93
1 boulevard Lénine, 93 000 Bobigny – Salle Christian Bourgeois
www.mc93.com
Et en tournée du 4 au 13 février 2010
Théâtre des Célestins
Place des Célestins, 69 002 Lyon
www.celestins-lyon.org
Voir aussi :
La critique de Bruno Deslot à propos du livre La Noce
Read More →
Rencontre avec l’auteure, metteuse en scène et comédienne Carole Thibaut
// Jan 11th, 2010
Une rencontre de Bruno Deslot –
Auteure, metteuse en scène et comédienne, Carole Thibaut poursuit, depuis 2001, son travail autour des écritures contemporaines. Elle crée et développe chaque saison des projets artistiques en direction de publics de différentes cultures et origines sociales, s’attachant à croiser et à confronter les paroles et les voix de chacun, en lien étroit avec son propre travail de recherche. En 2008-2009, elle a écrit et interprété Histoire de résonances, en collaboration avec le compositeur François Méchali, a joué dans Cut, d’Emmanuelle Marie, mise en scène de Jacques Descordes au Théâtre du Rond Point et a créé Fantaisies qu’elle écrit, met en scène et interprète. En 2009, elle reçoit le prix nouveau talent théâtre SACD et sa pièce, Avec le couteau le pain, vient de paraître aux éditions Lansman.
Rencontre avec Carole Thibaut
Fantaisies est une création proposant une représentation de la femme, a contrario, de celle que la société véhicule. Votre spectacle s’intitule Fantaisies ou l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était ! L’idéal féminin n’est-il pas aussi un désir de femme ?
Carole Thibaut : Je crois que c’est un désir de société. Un désir social d’une identité qui existe ou qui n’existe pas, ça c’est une autre question. C’est la question que pose le spectacle d’une certaine manière. L’idéal féminin est un désir de femme dès lors qu’il est guidé par un désir social et culturel bien ancré dans les représentations collectives. Mais, je ne pense pas que ce soit un désir de femme, comme certains peuvent le défendre. Durant le spectacle, je tente d’interroger ce désir, mais il est difficile de s’émanciper de la représentation de cet idéal féminin, construit depuis des siècles, que ce soit dans nos sociétés occidentales ou dans n’importe quelle autre société puisque l’idéal féminin est quelque chose d’assez universel.
Quels sont vos auteurs de prédilection qui guident votre réflexion et accompagnent l’évolution de vos créations ?
CT : Cela peut être des anthropologues comme Françoise Héritier, ou des gens qui ont fait un travail plus journalistique, des écrits psychanalytiques aussi autour de la théorie du phallocentrisme dont je parle dans le spectacle. Cela peut aussi être des femmes ou des hommes que j’ai rencontré, de milieux culturels et sociaux très différents, qui permettent d’avoir des points de vue plus nuancés. Un écrivain comme Maupassant, qui a écrit des choses épouvantables sur les femmes fait partie de mes lectures, ou encore George Sand, que j’aime énormément aussi. Mais dès que l’on commence à interroger chacun ou chacune sur l’identité du genre, on se trouve face à de véritables contradictions. J’interroge le sujet de l’idéal féminin, non en tant que spécialiste mais en tant qu’artiste, avec ma propre expérience intime. Je tente de l’éclairer.
Au cours du spectacle, l’image de la femme se disloque, “ça” ne cesse de lui échapper. Faites vous référence au «ça» de Freud comme centre des pulsions qui constituent l’énergie psychique de l’individu ?
CT : “Ça”, freudien ou lacanien, c’est aussi la chose que l’on ne peut pas dire, celle que l’on ne peut pas nommer. Le sexe de la femme est nommé de plein de manière et n’est pas nommé à la fois. C’est un endroit non défini. Chez Lacan, c’est le trou noir, la chose qui engloutit tout. “Ça” échappe à la femme parce qu’on lui a interdit, d’une certaine manière, de le nommer. “Ça” est quelque chose dont on ne peut pas parler, qui est mal défini, parfois même innommable. Tout ce qui est lié au sexe de la femme est caché.
Allez-vous utiliser votre corps pour parler de «ça» au cours de votre spectacle ?
CT : J’utilise le corps, le son, le jeu théâtral et interroge la représentation de l’idéal féminin autour de l’identité du genre. J’interroge donc les différentes représentations sexuées à partir des représentations déjà établies. Je joue avec les codes théâtraux comme celui du sitcom qui interroge une représentation sexuée assez forte qui est celle de la « pétasse ». J’ai appelé ce spectacle Fantaisies surtout par rapport à là où m’ont emmenées mes propres pérégrinations et c’est pour cela que c’est un spectacle qui évolue constamment.
Votre spectacle s’enrichira donc au gré des rencontres que vous effectuerez ?
CT : Je rencontre des gens qui s’avèrent être plus souvent des femmes que des hommes, car dans certaines structures, il est plus facile d’en rencontrer. A travers ces rencontres, je nourris le spectacle, mais cela peut aussi avoir lieu lorsque je rencontre une femme au cours d’une discussion, ce qui ne veut pas dire que je suis toujours en état d’alerte ! De manière presque inconsciente, ces rencontres m’enrichissent et me permettent, à chaque fois que je retourne sur le plateau, de faire renaître autre chose. Et puis, c’est aussi ma propre évolution de femme qui nourrit le spectacle.
Droit de vote de la femme, lois sur l’avortement, parité homme/femme, vous parlez d’un grand bouleversement, en pressentez vous un autre ?
CT : Je crois que l’on est en plein bouleversement à tout point de vue. Lorsque je vois l’évolution entre ma mère, moi et ce que sera la vie de ma fille, en 30 ans, j’observe une évolution considérable. C’est un bouleversement que l’humanité n’a jamais connu auparavant, jamais ! Tous les repères, les fondements de nos sociétés, patriarcales à l’origine, sont bouleversés, bousculés. D’où un certain malaise. Le discours sur la virginité, par exemple, est particulièrement rétrograde, même dans un pays comme les Etats-Unis. Les religions sont une des premières ennemies des femmes parce qu’elles font référence à des époques historiques complètement révolues.
Vos actions avec des collectifs de femmes, d’horizons divers, consistent-elles à rendre la parole à cette moitié d’humanité qu’est la femme, comme vous le dites dans votre spectacle ?
CT : Mes créations ne sont pas toujours issues de ce travail là, mais j’ai absolument besoin de nourrir mon parcours de ces rencontres. Les femmes, que je rencontre, sont des groupes qui m’émeuvent beaucoup, non seulement parce que ce sont des personnes dans des situations précaires, mais aussi parce que dans ces situations difficiles, ce sont toujours les femmes les plus défavorisées. Elles sont toujours opprimées intérieurement. Ces rencontres me permettent de sortir des références convenues et trop confortables dans lesquelles nous évoluons. Le principe de la pensée unique assèche l’être humain d’un point de vue artistique. Le fait de travailler avec des gens différents, permet de rester en alerte sur le monde. Il me semble que l’artiste est au cœur même de la rencontre humaine qui tisse quelque chose entre différents regards. Dans ce spectacle, je ne fais qu’interroger ma propre représentation sociale à travers le prisme du féminin. Le spectacle s’appelle Fantaisies car je n’ai vraiment pas envie de me prendre au sérieux avec toutes mes interrogations. Je m’en amuse beaucoup, au contraire.
Voir l’article
Fantaisies
ou l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était
De et avec : Carole Thibaut
Du jeudi 14 au samedi 30 janvier 2010
Confluences
190 bd de Charonne
75020 Paris
www.confluences.jimdo.com
Read More →
« Vienne 1913 » d’Alain Didier-Weill au Théâtre du Lierre
// Jan 11th, 2010
Critique de Bettina Jacquemin –
Destins croisés
En avril 1909, dans le parc du Prater à Vienne, un jeune homme va passer la nuit de ses 20 ans sur un banc, seul avec un chien errant, tandis qu’au loin, la capitale de l’empire austro-hongrois brille de tous ses feux, en pleine effervescence artistique, scientifique et politique.
Un jeune homme pauvre qui survit misérablement dans un asile, étudie le dessin à l’école des Beaux-Arts de Vienne. Ce garçon, qui vient de fêter ses 20 ans, rencontre un jeune homme, brillant, beau, héritier de la célèbre aristocratie viennoise. Mais voilà, ce jeune homme nanti, a un dilemme qui le ronge… Il est antisémite. Le psychanalyste Jung trouve alors très intéressant de l’envoyer consulter son maître Freud.
Ces deux jeunes gens vont ainsi se confronter, parallèlement et ensemble, à tous les aspects de la société viennoise et se forger quelques idéaux définitifs. Le jeune homme pauvre s’appelle Adolf… Adolf Hitler.
Basculement subtil et grinçant
Il y a de ces spectacles dont l’atmosphère vous saisit immédiatement. Vienne 1913 est de ceux là.
L’ambiance est sombre. Mais le décor est esthétique. A peine entrés dans la salle, on remarque ce lustre de fils de fer rouge. Les comédiens s’installent tel un orchestre viennois. Des sonorités troublantes émanent de verres en cristal.
Il y a Hugo qui tente de comprendre son antisémitisme obsessionnel auprès de Freud. Et Adolph, qui s’éveille au Nationalisme allemand. Les tableaux s’alternent. On y rencontre Jung, Marx, Klimt…
Comment, dans une société où se côtoient artistes et intellectuels, les germes de la barbarie peuvent-ils apparaître?
L’auteur, Alain Didier-Weill s’interroge sur le « basculement du côté du mal ». Mais, il propose une explication quelque peu agressive. La remarquable interprétation de Miguel-Ange Sarmiento adoucit heureusement un récit psychanalytique parfois un peu trop didactique. Il mène le personnage d’Adolf H LENTEMENT vers la paranoïa.
Bien évidemment, « nous pensons d’un bout à l’autre de la pièce à la suite de l’histoire… ».
Vienne 1913
De : Alain Didier-Weill
Par : la Cie Influenscènes
Mise en scène : Jean-Luc Paliès
Avec : Miguel-Ange Sarmiento, Philippe Beheydt, Bagheera Poulin, Jean-Pierre Hutinet, Jean-Luc Paliès, Alain Guillo, Katia Dimitrova, Claudine Fiévet, Stéphanie Boré
Les chanteuses et musiciennes : Estelle Boin et Geneviève Botteau
Musique sur verre : Jean-Claude Chapuis
Lumières : Jean-François Saliéri
Création musique : Jean-Claude Chapuis
Du 6 au 24 janvier 2010
Théâtre du Lierre
22 rue du Chevaleret, 75013 Paris – 01 45 86 55 83
www.letheatredulierre.com
Read More →
« Perthus » de Jean-Marie Besset au Vingtième théâtre
// Jan 10th, 2010
Critique d’Evariste Lago –
Etre ou bien paraître
Passage à l’âge adulte, liberté d’initiative, reproduction de schémas parentaux, absence du père et influence étouffante de certaines mères… Vaste programme à dérouler en une heure quarante mais pari accompli pour Jean-Marie Besset qui réussi à nouer toutes ces problématiques au travers d’une histoire crédible et poignante, avec pour toile de fond l’homosexualité acceptée ou refoulée de deux post-adolescents.
Décennie 70. Paul, en première, n’aime pas les maths mais aime la Princesse de Clèves et déjà le nouveau terminal, Jean-Louis. Jean-Louis, lui, n’aime pas la Princesse de Clèves, aime les maths et apprécie Paul. Tandis qu’ils échangent un soutien scolaire, débouchant sur un échange de sentiments, leurs mères, Irène et Marianne, délaissées par leur mari, échangent un soutien moral. L’échéance du bac – métaphore de l’entrée dans la vie adulte – approchant, la relation des garçons évolue au gré des pressions familiales. Jean-Louis, cartésien, binaire, fort en suite logique reprend le flambeau paternel. Paul, dans une acceptation totale de son idiosyncrasie, et contrairement à la Princesse de Clèves, réussit à se détacher des préceptes maternels.
L’amour toujours l’amour
Sylvain Dieuaide et Brice Hillairet, dirigés par Gilbert Désveaux, mettent en scène les éléments du décor au fur et à mesure de l’avancée de la pièce. Disposées sur des praticables, quatre chaises géantes, utilisées à bon escient, ponctuent habilement les différents tableaux, traités de manière quasi cinématographique. Quatre chaises pour quatre personnages. La parole est juste et les mots sonnent vrais, même pour les mères incarnées par deux hommes, Alain Marcel et Laurent Spielvogel. Loin de la caricature traditionnelle de l’homme travesti, on en vient à oublier le sexe réel de l’interprète, le jeu et le texte l’emportant sur les lieux communs. L’exercice est périlleux mais réussi pour Jean-Marie Besset qui traite à nouveau de l’homosexualité masculine. Un thème qu’il connaît bien. Ce sujet parle à tous, sans détour ni pédanterie, grâce à une écriture délicate et parfois incisive. L’interprétation est tendre pour l’évocation des sentiments adolescents confus et naissants, ici traités et joués avec vérité. L’auteur a su évoquer, avec des touches cruelles, de l’amour au féminin, de l’amour au masculin, de la perte de l’amour, des relations filiales, des rapports humains en somme, de nous. Comment ne pas être interpellé ?
Perthus
Deux mères, deux fils…
De : Jean-Marie Besset
Mise en scène : Gilbert Desveaux
Avec : Alain Marcel, Laurent Spielvogel, Sylvain Dieuaide, Brice Hillairet
Décor : Alain Lagarde
Lumières : Pierre Peyronnet
Costumes : Dominique Borg
Du 8 janvier au 28 février 2010
Vingtième Théâtre
20 rue des Plâtrières, 75020 Paris
www.vingtiemetheatre.com
Read More →
« Le garçon de passage » de Dominique Richard
// Jan 10th, 2010
Lecture d’Hervé Mestron –
Un parcours initiatique
Le temps d’une journée et d’une nuit d’été, le garçon et la fille emmènent le garçon de passage dans leur île mystérieuse. Pour faire partie de leur clan, ce dernier devra réussir un certain nombre d’épreuves…
La pièce débute au moment où l’île paraît en déséquilibre sur l’eau, comme en instance de rupture avec la magie du ciel. Le garçon et la fille ont hérité de ce lieu que leur a laissé le grand, aujourd’hui parti dans le monde des adultes.
L’arrivée du garçon de passage va les obliger à prendre la place de celui qui autrefois savait les rassurer, les enchanter. A eux maintenant de gérer les mystères, d’organiser les épreuves initiatiques, et d’entretenir la santé d’un dialecte codé : le Pallakch, leur langue intime, chargée de symboles et de perles philosophiques : « Le garçon : Do, en pallakch, c’est la pensée, et ma, l’obéissance et la promesse. Le b de la fin, c’est le signe du soi… Un truc comme la sagesse, mais en pallakch, c’est plus riche. »
C’est en jouant à y croire à nouveau que l’écorce des rêves va peu à peu se craqueler, comme si cela ne pouvait pas durer éternellement.
Dialogues et récit s’entremêlent pour créer la lente et inexorable avancée du temps, donnant à cette fable la douceur d’un soleil initiatique. Les personnages quittent l’enfance, attirés malgré eux par d’autres sensations, d’autres pulsions.
Une écriture pudique et vibrante, qui décrit ce glissement, entre perte de l’innocence et acceptation du réel.
Le Garçon de Passage
De Dominique Richard
Editions Théâtrales Jeunesse
20 rue Voltaire, 93100 Montreuil
www.editionstheatrales.fr
Read More →
« La Trafiquante » A partir des poèmes de Kaplan, Norac, Pittau, Roubaud et Rouzeau
// Jan 10th, 2010
Critique de Bruno Deslot –
Des mots et des couleurs
Des boîtes, des mots, des animaux et des poèmes, la trafiquante compose, illustre la poésie de son imagination.
Mystérieuses boîtes qui ne tardent plus à s’ouvrir pour libérer la poésie illustrée de la Trafiquante. Cette jeune femme cache, au fond de ses boîtes, un monde imaginaire dont elle raconte l’histoire, enfin les histoires, au rythme plaisant et musical d’une belle aventure en prose. Des mots courts, longs, en vers ou en prose accompagnent des histoires d’animaux, de tortues, de vieilles femmes en ville, de chats poilus et lèvent le voile sur l’espace animé et coloré que la trafiquante compose sous nos yeux. Car, trafiquante son père l’a baptisée, trafiquante elle touche à tout ce qui la fait rêver. « Voici d’iliade longtemps / j’étais petite enfant / Et je touchais à tout / Alors «la trafiquante » mon père me baptisa ». Un sobriquet bien à propos, pour une jeune fille aussi habile de ses mains, plongeant jusqu’au fond de ses boîtes pour y sortir des « trucs » qu’elle personnifie avec espièglerie. D’une boîte à l’autre, la voici animant des mots muets et des images immobiles. Tout existe, prend forme et voix dès lors que la trafiquante s’en empare avec la magie de ses ciseaux, pour découper une silhouette qui lui ressemble, ou dévoiler une lune et des étoiles, suspendues à un câble que parcoure une tortue. En ombre chinoise, une vielle femme traverse la ville pendant que le métro passe bruyamment. Autant d’illustrations que les mots accompagnent dans une parfaite symbiose malicieuse et enfantine. La trafiquante ouvre ses boîtes pour répandre les couleurs du bonheur, Zeus ne lui a pas interdit, elles ne contiennent pas le mal de celle de Pandore.
Rêveries de la trafiquante solitaire
De la poésie et des couleurs, Lara Bruhl embrasse la vie en sortant de ses boîtes des « trucs » qui étayent le champ lexical de ses rêveries. Incarnant l’héroïne d’un poème de Valérie Rouzeau, elle s’amuse à parcourir l’univers candide des mots de Norac, Roubaud, Pittau et Kaplan pour les trafiquer à sa manière. Elle met les mots en images en utilisant des personnages au destin singulier dès lors qu’ils sortent de l’anonymat des boîtes dans lesquelles ils sont enfermés. Bérangère Vantusso réalise une mise en scène simple et efficace qui facilite la compréhension des poèmes tronqués pour le plus grand plaisir de cette trafiquante malicieuse et complice du regard de l’enfant. Des découpages et des couleurs suffisamment explicites, accompagnent les histoires de cette jeune femme à l’imagination débordante. L’enfant peut ainsi se saisir de tout ce matériau en devenir, pour s’approprier, au mieux, ce qui est dit. La voix chaude et grave de Lara Bruhl crée une ambiance intimiste dans laquelle les mots sont lâchés comme des secrets. Un bel hommage à la vie et au bonheur pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes, bien sûr.
La Trafiquante
A partir des poèmes de : Leslie Kaplan, Carl Norac, Francesco Pittau, Jacques Roubaud et Valérie Rouzeau.
Mise en scène et conception des marionnettes : Bérangère Vantuso
Avec : Lara Bruhl
Illustrations : Kitty Crowther, Bernadette Gervais, Dominique Maes, Lionel Le Néouanic et Stéphane Poulin
Du 6 janvier au 27 février 2010
Maison de la Poésie
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75 003 Paris
www.maisondelapoesieparis.com
Read More →
Copyright © 2009 Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales parisien.
All rights reserved.


 Billet des Auteurs de Theatre
Billet des Auteurs de Theatre Editions Mandarines
Editions Mandarines Paroles francophones
Paroles francophones Théâtre du Rond Point
Théâtre du Rond Point